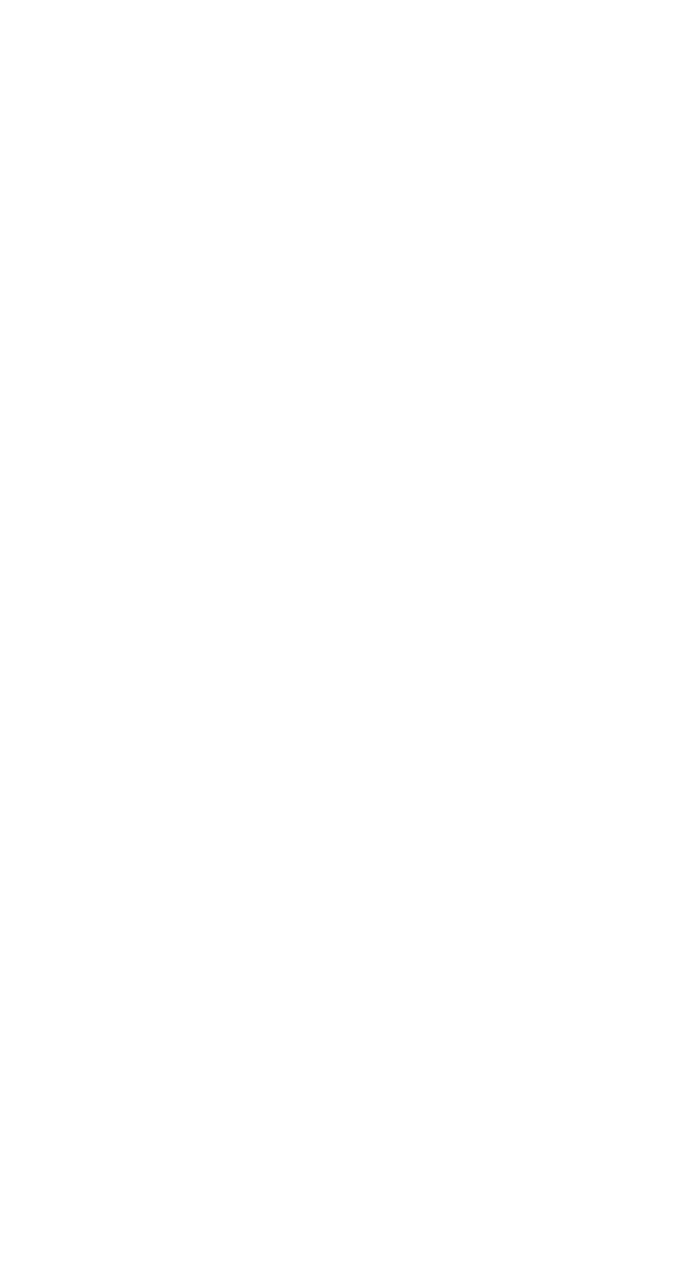Le CRG by Michel Berry - Episode 1
Lors de la fête des cinquante ans du CRG, j’ai été invité à témoigner sur les débuts du centre, que j’ai évoqués sous le titre : “De l’ambiance start-up au combat de l’institutionnalisation”, et plusieurs m’ont dit que je devrais écrire cette histoire. La création d’un site consacré à l’histoire du CRG en a créé l’opportunité. Je ne prétends pas être exhaustif dans ce témoignage, et il est possible que cette histoire comporte un biais, celui du point de vue de directeur que j’ai assumé de 1975 à 1991. D’autres pourront le compléter et le contester, dans la tradition de la controverse qui a toujours été pour moi un moteur essentiel de la création.
Au fil de l’écriture, je me suis rendu compte que j’avais beaucoup à dire, au risque de lasser le lecteur et d’impatienter mes commanditaires, Étienne Minvielle et Catherine Gayda. J’ai alors proposé d’écrire cette histoire en plusieurs épisodes, et Étienne Minvielle m’a dit « pourquoi pas une série Le CRG by Michel Berry » ? Cette idée m’a plu…
Une rencontre inattendue
Après avoir passé quatre ans au CGS, j’envisage d’aller vers de nouveaux horizons car j’ai besoin d’exprimer mon goût pour animer des équipes. C’est alors que Bertrand Collomb, que je connais de loin, me fait demander, fin 1973, par Denis Bayart si nous pouvons déjeuner tous les trois. Je connais Denis, camarade de promotion de mon frère Gérard, et Bertrand se dit sans doute qu’en organisant un déjeuner par son intermédiaire, il pourrait m’observer sans s’engager[1]. Nous discutons particulièrement ce que je fais au CGS.
Quelque temps plus tard, il me demande si je peux rencontrer la petite équipe du Groupe de recherche en gestion des organisations (GREGOR) de l’X, créé un an auparavant. La réunion dure trois heures. Je parle de nos découvertes au CGS lorsque nous avons essayé d’appliquer des modèles de recherche opérationnelle, et rencontré des obstacles des toute sortes, ce qui est en train d’amener à une reformulation de notre objet de recherche. Il ne s’agit plus de nous définir comme des fabricants de bons modèles, mais comme des chercheurs explorant le fonctionnement des organisations à travers une pratique clinique : en essayant de créer et d’appliquer des modèles, nous avons eu accès à des détails de la vie intime des organisations usuellement cachés aux chercheurs. Je parle surtout d’une expérience fraîche, appelée le Jeu Peugeot, qui interpelle l’équipe. Je crois utile de l’évoquer même si elle est bien connue des anciens, car elle jouera un rôle important dans la suite.
Le jeu Peugeot. J’avais animé pendant trois ans une étude chez Peugeot qui avait bien commencé : deux élèves de l’option « gestion scientifique » de l’École des mines avaient résolu de manière admirable un problème d’optimisation de l’envoi par voie ferrée des voitures fabriquées par l’entreprise jusqu’aux points de vente. Un élève ayant choisi de continuer au CGS, nous avons proposé à nos interlocuteurs de les aider à mettre en œuvre du modèle. S’est alors engagée une aventure marquée de rebondissements et de résistances d’acteurs semblant animés par une condamnable mauvaise foi. Tout s’est fini dans la confusion.
Une expérience faite un peu plus tard a apporté un éclairage inattendu. Nous avions créé, pour préparer les élèves de l’option à leur travail sur le terrain, une semaine « d’exercices de gestion scientifique », en leur faisait vivre en petits groupes des études du CGS. Nous avions choisi l’étude Peugeot pour l’un des groupes. Nous avons posé aux élèves le problème initial et, pendant deux jours et demi, ils ont travaillé à le résoudre, retrouvant le même modèle que celui mis au point par leurs aînés. Quand ils alignaient les équations au tableau, ils étaient en lévitation. Puis nous leur avons attribué cinq rôles : directeur général, responsable commercial, filiale propriétaire des wagons (Gefco), service chargé de mettre les voitures sur les wagons, chercheur. Chacun avait des informations différentes, proches des informations réelles (reconstituées a posteriori pour certaines). Trois réunions d’une demi-journée étaient organisées pour prendre des décisions pour faire avancer le projet (elles condensaient une dizaine de réunions qu’il y avait eu dans le réel).
Les élèves se sont pris au jeu, chacun rentrant dans le rôle qui lui était dévolu et défendant sa position, parfois bec et ongles. Notre stupéfaction vint de ce que les élèves ont reproduit les mêmes comportements que les acteurs réels, prirent les mêmes décisions, même celles qui étaient apparues absurdes. Nous avions reconstitué le déroulement des événements, qui n’étaient donc plus erratiques mais régis par des forces dépassant les acteurs. Les responsables de Peugeot en ont été stupéfaits, comme déculpabilisés (“si les élèves font comme nous, alors nous n’avons peut-être pas mal fait”), ce qui nous a réconciliés.
Je propose alors l’idée suivante aux membres. Les grands espoirs mis dans la recherche opérationnelle butent sur le fait que la rationalité n’a pas, dans l’entreprise, la place que lui attribuent les économistes et les adeptes de la « Management science ». Les acteurs sont en effet pris dans des logiques locales propres, liées à leurs fonctions et à la façon dont ils sont jugés. Plutôt que de définir la recherche en gestion comme le moyen de créer des outils rationnels de décision et de gestion, elle devrait s’attacher à comprendre les « mécanismes de gestion » qui régissent le comportement des acteurs et le fonctionnement des organisations. La pratique du CGS fournit un riche matériau d’observation, et ses premières interprétations donnent de premières clés d’analyse, mais on devrait pouvoir mobiliser des sciences humaines pour décrypter de manière plus approfondie ces logiques. Cela tombe bien, mes interlocuteurs s’intéressent aux sciences humaines, disciplines devenues à la mode après 1968.
La proposition
Quelque temps plus tard, Bertrand me demande si j’accepte de prendre la direction du Gregor, et je lui dis oui, sans réfléchir plus avant. (J’ai appris longtemps plus tard qu’il avait fait voter l’équipe pour savoir si elle m’acceptait comme directeur).
Il me donne des détails sur le contexte de l’X, l’équipe, les locaux, etc. Un point me marque quand il me dit : “nous avons quatre axes de recherche”, et quelques minutes plus tard, “nous avons quatre chercheurs”. Je me dis : “ça commence bien !” Jean-Pierre Ponssard (X 66) fait un PHD à Stanford centré sur la théorie des jeux. Jacques Girin (X67) finit une formation à la sociologie des organisations auprès de Michel Crozier. Denis Bayart (X 67) travaille sur une thèse fondée sur le traitement statistique et Jacques Sarrazin (Mines de Nancy) va faire un PHD à Austin (Texas) après avoir soutenu une thèse à Dauphine. Allait arriver, avec une petite équipe, Jean de Kervasdoué, PHD de sociologie quantitative des organisations à Cornell.
Comment faire en sorte que cela ne tourne pas à la Tour de Babel ? La solution me paraît évidente : il faut faire œuvre de pluridisciplinarité, thème à la mode, et créer une démarche au point de rencontre imaginaire entre l’économie, la sociologie, le management, la psychosociologie… Mais cela suppose une stratégie ambitieuse.
Les premiers pas
La transition d’avec le CGS se fait progressivement courant 1974. Bertrand Collomb, nommé au cabinet d’Alain Peyrefitte, ministre de la Réforme administrative, n’avait plus le temps de diriger le GREGOR, d’où l’offre qu’il m’a faite. Il me propose de venir à mi-temps pendant un an. Il consacre un peu de temps à l’équipe, m’aide à prendre ma fonction, et je m’en rends compte rapidement, veille à ce que je prenne une “bonne direction”. Cela me permet de faire connaissance de l’équipe, les chercheurs déjà cités, et aussi le personnel “administratif”. Elisabeth Szuyska, DEA d’histoire, me dit rapidement qu’elle n’est pas faite pour être secrétaire et qu’il faut que j’embauche quelqu’un pour cela. Je le regrette car elle tape à la vitesse de l’éclair et a une plume exceptionnelle qui améliore les textes que je lui donne à taper, mais je recrute une secrétaire, Caroline Mathieu. Elle deviendra d‘ailleurs rapidement bibliothécaire, laissant sa place à Monique Tardif recrutée plus tard.
Arrive un jeune X, titulaire d’une bourse de thèse de l’École, Gérard de Pouvourville, recruté par Bertrand Collomb. Il a une tâche redoutable : mettre de l’ordre dans les enseignements d’option de l’X. Avec les réformes postérieures à 1968, ont été créées des options dans différentes matières pour le dernier semestre de la scolarité. L’économie et la gestion attirent près de 250 élèves, pendant que les chimistes n’en ont qu’une dizaine. Cela crée des tensions entre départements, mais surtout le département d’économie est dépassé par le nombre d’élèves : beaucoup d’élèves seuls leurs sujets avec des entreprises, et la qualité pédagogique de leur travail n’est pas toujours assurée.
Un des motifs de la création du GREGOR avait ainsi été de mettre de l’ordre dans les options, et Gérard a ce rôle : définir des sujets de mémoire de terrain, en discuter avec les entreprises et les proposer aux élèves en veillant à ce qu’ils soient correctement suivis en entreprise. C’est un travail considérable dont il s’acquitte remarquablement. Et cela crée un lien avec l’enseignement qui sera décisif pour le CRG. J’interviens aussi comme enseignant de petites classes d’économie d’entreprise.
Je fais connaissance de Michel Crozier qui donne des cours dans le département humanités et sciences sociales. Ses cours passent mal : Les élèves pensent souvent que ce qui ne ressemble pas aux mathématiques est du « baratin ». On verra que Michel Crozier trouvera l’écoute grâce à nous.
Dans le courant de l’année 1974, je découvre les centres d’intérêt des membres de l’équipe et j’estime leur ouverture aux changements que j’ai en tête. Je fais la connaissance des responsables de l’école. Henri Piatier, le directeur de l’enseignement et de la recherche, échange souvent avec moi appréciant les distances que je prends avec l’économie dont son frère André est un professeur réputé. Un autre interlocuteur important est Pierre Vasseur, directeur des laboratoires, qui a comme priorité d’aider les deux laboratoires récemment créés : le Centre de mathématiques appliquées et le Grégor. C’est un adepte du tennis et l’École dispose d’un court sur lequel faisons des parties endiablées avec lui, ce qui crée des liens qui aideront à régler certains de nos problèmes.
Je commence à mettre en place des dispositifs de travail, et je fais comprendre à Bertrand que je n’ai pas besoin d’être conseillé, ce qu’il accepte en s’effaçant tout en m’aidant à ma demande. Je lui dis que ma nomination comme directeur doit passer par la création d’un centre de recherche autonome. Le Grégor avait en effet été créé comme équipe du Centre d’Économétrie, avec une grande autonomie, mais son responsable n’a que le statut de directeur adjoint du Centre. C’est ce qui est prévu et nous discutons âprement dans l’équipe du nom du centre, ce sera Centre de recherche en gestion. J’en suis nommé directeur le 1er janvier 1975 avec le grade de maître recherche à l’École polytechnique.
UNE STRATÉGIE MODE START-UP
Ma stratégie, mûrie pendant la transition, est organisée autour de principes simples : créer des dialogues à haute intensité ; développer des recherches de terrain ; miser sur l’enseignement ; publier en ignorant les revues académiques au début ; recruter rapidement, notamment des jeunes ; mettre en place un mode de rémunération égalitaire. On dirait aujourd’hui c’était une démarche disruptive.
Créer des dialogues à haute intensité
Pour créer une culture commune avec des points de départ si différents, il faut provoquer des dialogues à haute intensité. Dès avant ma prise de fonction officielle, je crée des réunions d’une demi-journée par semaine, obligatoires, pour discuter collectivement des travaux en cours. Cela ne va pas sans mal, les chercheurs sont parfois peu soucieux de discuter avec des personnes « qui ne le comprennent pas ». Bertrand Collomb avait déjà connu le problème, et constatant qu’un chercheur était volontiers absent aux réunions, il l’a fait chercher chez lui par un motard (moyen dont dispose un membre de cabinet). L’affaire, traitée avec humour, a eu un effet radical sur le présentéisme…
Je me rends vite compte que si l’on fait discuter un économiste et un sociologue sur les fondements ultimes de leur discipline, cela tourne à la guerre : si tu as raison, j’ai tort et réciproquement. En revanche si la discussion porte sur un matériau d’observation, un dialogue peut s’enclencher. Chacun peut montrer comment sa discipline peut éclairer les problèmes : tel propose une lecture en termes de relations de pouvoirs, un autre en termes de rapports sociaux, ou d’influence des outils de gestion, etc. La discussion peut être animée mais ces échanges à haute intensité sont féconds, et nous développons une culture collective large et profonde. Pour déplacer les équilibres vers leur discipline favorite, les chercheurs ont même du talent pédagogique, ce qui accélère la compréhension des autres sur un domaine qui ne leur est pas familier.
Nous créons une « commission lecture » pour discuter de grands ouvrages des sciences sociales, la discussion étant lancée par un membre de l’équipe qui résume le livre. Weber, Marx, Crozier, Foucault, Bourdieu, Devereux, etc., sont ainsi analysés.
Comment accéder au terrain ?
Une clé du succès du dialogue est donc de l’organiser autour de l’analyse de matériaux issus du terrain. Mais comment accéder à des terrains ? L’observateur dérange, surtout s’il publie. C’est le problème rencontré par la recherche en gestion dans tous les pays. La présence du chercheur curieux est donc une anomalie qu’il faut rendre possible, puis la gérer jusqu’à la publication.
Cela demande une grande préparation, et pour commencer il faut que de premières entreprises fassent confiance aux chercheurs. Mais comment commencer ? L’étiquette d’ingénieur, plutôt que de sociologue, rassure, et les réseaux dont dispose l’X peuvent aider, mais cela ne suffit pas. Il faut que quelqu’un suffisamment bien placé fasse confiance à un centre ou une personne. À sa création, le CRG ne peut pas être investi d’une confiance, et les premiers travaux sont lancés par des relations personnelles. Je tire en particulier parti de celles que j’avais développées au CGS.
Une première demande émane de chez Renault, où je suis connu. Le directeur de la réforme des méthodes de gestion, fonction nouvellement créée, me propose d’étudier l’organisation des achats de l’entreprise qui, selon lui, doit être revue de fond en comble. J’accepte cette proposition parce que la demande est aussi appuyée par le nouveau directeur des achats, avec qui j’avais mené plusieurs études au CGS quand il était directeur industriel. Il est curieux de savoir ce que nous pourrions découvrir, les dysfonctionnements étant attribuables à son prédécesseur. Cela nous évite d’être inféodés à la demande d’un seul acteur, ce qui, nous le verrons, est essentiel. Nous partons avec deux jeunes sous ma direction, Gérard de Pouvourville et Yves Cohen-Hadria, à l’assaut d’une citadelle de 700 acheteurs négociant plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise, ce qui peut paraître extravaguant.
Puis les opportunités multiplient, grâce à la création d’une option pour les élèves de l’École.
L’option « processus de décision dans les organisations »
À l’École polytechnique, il paraît essentiel que le CRG soit impliqué dans l’enseignement. C’est une création récente, surprenante même pour nombre de collègues. Rester un laboratoire atypique au milieu d’une vingtaine de laboratoires de sciences « dures » peut le mettre en position précaire, et nous verrons que son insertion n’a pas été de tout repos. Jouer un rôle dans l’enseignement des X, le cœur de l’identité et de la réputation de l’École, est donc vital.
Mais comment enseigner la gestion à des élèves sortant de taupe, pour qui ce qui ne ressemble pas à des maths que c’est du “baratin” ? Il me paraît quasi-suicidaire de donner des cours de management en amphi devant 300 élèves. L’enseigner dans une « petite classe » de 25 élèves est envisageable, mais il faut l’accord du département d’un département d’enseignement, ce qui n’est guère envisageable : le département d’économie se recentre sur l’économie mathématiques, sous l’impulsion de Thierry de Montbrial nommé président du département en 1974 ; pour le département Humanités et sciences sociales, le management est une discipline suspecte.
Une opportunité se présente toutefois avec les options du dernier semestre. Comme beaucoup trop d’élèves choisissent les options économie et gestion et qu’il faut y mettre de l’ordre, nous proposons à la direction de l’École, qui nous soutient, de créer une option en gestion. Nous l’appelons « Processus de décision dans les organisations », ce qui semble plaire, et la limitons à 12 ou 14 élèves (six ou sept binômes). Pour ne pas susciter de rejet du corps enseignant, il nous faut rester à la marge. De plus, un petit nombre d’élèves permet un enseignement de qualité.
Le rôle de Gérard de Pouvourville facilite bien sûr cette démarche, et nous cherchons avec lui des sujets de mémoire qui peuvent accrocher des élèves, avec de bons interlocuteurs sur le terrain.
L’option est créée en 1975 et nous ne manquons pas de candidats. Les mémoires sont précédés d’un séminaire de deux semaines pour les sensibiliser aux limites des outils rationnels. Tout au long du stage, nous les faisons venir à l’École un jour par semaine pour leur donner des cours, et organiser des échanges sur leurs idées de mémoires.
Nous commençons le séminaire par le jeu Peugeot pendant une semaine. Comme il faut attribuer cinq rôles, deux groupes jouent en parallèle, certains rôles étant assumés par deux élèves. La magie de l’expérience se reproduit. Les élèves sont en quasi-extase lorsqu’ils écrivent les équations et décontenancés quand ils voient que tout leur échappe lors des réunions. Ils s’affrontent, et prennent les mêmes décisions surprenantes. L’un d’eux, décontenancé par l’opposition du « responsable commercial » me demande si je lui ai donné la consigne de jouer au débile. Je lui réponds : « Non c’est un élève promotion qui connaît aussi bien le modèle que toi et qui essaie de t’expliquer le problème que pose sa mise en œuvre », ce qui le plonge dans un abîme de perplexité.
Il faut laisser passer du temps pour les mettre dans une posture propice au débriefing. Cette expérience marque tellement certains élèves qu’ils s’engagent en thèse avec nous à la fin de l’option.
En deuxième semaine, nous leur proposons des clés de lecture du fonctionnement des organisations. Ils boivent les paroles de Michel Crozier. Celui-ci parlera d’ailleurs avec émotion dans ses mémoires de la façon dont le Jeu Peugeot a ouvert les élèves à des concepts auxquels leurs camarades étaient fermés les années précédentes.
Pour le stage, chaque binôme est suivi par un binôme de chercheurs. Les chercheurs ne doivent pas imposer aux élèves une problématique qui leur est chère, mais les aider à trouver la leur. Je propose d’encadrer les élèves par un binôme de chercheurs pour accélérer la prise de conscience par ces derniers des enjeux du travail de terrain : comment se faire accepter des acteurs, les mettre en confiance, valider les informations qu’ils donnent ou les contester, etc. ? Je suis de près ce travail d’encadrement pour les aider les chercheurs à jouer ce rôle qui peut leur paraître inhabituel.
Pour la première année d’option, les stages sont très appréciés par les élèves et les organismes d’accueil. Ces travaux ouvrent de plus des terrains pour le CRG. Soit parce qu’un élève prolonge son mémoire pour en faire une thèse, soit parce que les encadrants des élèves sont appréciés par leurs interlocuteurs, qui proposent la poursuite du travail, ou d’autres thèmes d’investigation. Ainsi un mémoire ayant pour objet de comparer la dyalise rénale et la transplantation selon les dimensions économiques, médicales et du bien-être des patients, piloté par Gérard de Pouvourville, est à l’origine de nombreux travaux du CRG sur la Santé.
Donner aux chercheurs le goût du terrain
Pour mener des recherches de terrain, encore faut-il que les chercheurs en aient envie. Or, les relations ne sont pas toujours faciles sur le terrain : si quelqu’un en haut lieu est convaincu de l’opportunité d’une recherche, il est rare que les acteurs sur le terrain l’entendent de même. Il faut parfois du temps et le sens du contact pour mettre en place des relations. Par ailleurs les terrains peuvent être parfois loin de Paris, dans des lieux pas très fun. Enfin travailler de près avec l’entreprise sans perdre son âme ne tombe vraiment pas sous le sens dans la période post 1968. Les chercheurs de Michel Crozier sont ainsi régulièrement accusés de pactiser avec le diable. C’est moins vrai avec les ingénieurs mais je sens que certains membres de l’équipe sont réticents, ou anxieux, à l’idée de s’engager dans cette voie. L’encadrement des options calme progressivement ces angoisses et fait même découvrir que le terrain peut ouvrir à des thèmes de recherche passionnants.
Le recrutement de jeunes curieux de découvrir les entreprises facilite le développement de cette stratégie. Cette curiosité est fréquente chez les jeunes ingénieurs, de l’X ou d’autres écoles.
Une stratégie de publication transgressive
Il m’est tout de suite clair que la publication dans les revues académiques serait un obstacle à la création d’une équipe au carrefour de disciplines établies. Si chacun publie dans sa discipline, cela nuira aux échanges, voire les rendra impossible. Je prends alors une position qui paraîtrait extravagante aujourd’hui : celle de ne rien publier dans les revues académiques pendant au moins cinq ans, le temps de créer une équipe et d’avoir une problématique collective suffisamment forte. Sans aller jusqu’à interdire aux chercheurs de publier dans des revues académiques, je les en décourage.
Mais un centre de recherche se doit de publier pour faire connaître ses travaux, et parce que l’écriture est un moyen essentiel de mise en ordre des idées. Nous adoptons alors une politique de publication du CRG avec le label « Publication de l’École polytechnique » et en créons deux types : celles à couverture orange avec le titre en pleine page, considérées comme les meilleures, et celles à fenêtre avec une couverture verte. Chaque projet de publication est discuté collectivement, la question venant vite de savoir si elle aura droit à une couverture orange. Il en résulte des discussions très riches qui peuvent même devenir passionnées quand il s’agit de savoir à quelle couverture le texte aura droit, décision qui me revient in fine. Je ne suis pas sûr qu’on sache à l’extérieur la différence entre les deux types de publication, mais la discussion que cela entraîne est un moment important de la vie du CRG, qui fait parfois penser à la vie du village d’Astérix (“elle ne te plaît pas ma publication ?”), et ses moments de réconciliation.
Cette démarche est toutefois osée, même si l’on ne connaît pas encore l’hystérie du décompte des publications pour juger les chercheurs et classer les institutions, thème sur lequel je bataillerai plus tard. Pour assurer nos arrières, je demande rendez-vous à Bernard Grégory, professeur de physique mythique de L’École polytechnique, fondateur du CERN, Délégué général à la recherche scientifique et technique après avoir été Directeur général du CNRS. Il est président de la commission de la Recherche de l’École qui a avalisé la création du Grégor et ma nomination comme directeur du CRG.
Alors qu’il est très occupé, il me donne rapidement rendez-vous, et m’écoute longuement. Je lui parle de notre projet de démarche transdisciplinaire fondée sur une approche clinique. Après beaucoup de questions, il dit : « Ça se tente, je vous appuie et nous pourrons faire le point dans trois ans ». Fort de ce soutien, je dis au CRG que cette stratégie est confortée et j’en informe la direction de l’École.
Créer des relations pacifiques avec le CGS
Je me rends vite compte que le CGS fait peur au CRG, en particulier son directeur Claude Riveline. Il a des idées tranchantes. Il résume ainsi le comportement des agents en disant qu’ils optimisent les critères sur lesquels ils se sentent jugés, ce qui explique le rôle parfois extravaguant des chiffres. Pour analyser le changement, il propose un « couteau suisse » : la matière, les personnes, les institutions et la culture. Plus tard il utilisera un triptyque rites-mythes-tribus.. Les membres du CRG se rendent vite compte que, non seulement il a des idées tranchantes, mais qu’il déploie une énergie considérable pour les faire partager. Comme je viens du CGS, ils craignent que je sois l’agent de transmission de ses idées, et Jacques Girin me dit : « J’aime bien des idées de Claude Riveline (il aime des idées provoquantes), à condition qu’on ne cherche pas à me les imposer ». Par ailleurs le CGS paraît à l’époque beaucoup plus homogène que le CRG, comme sorte de machine de guerre, alors qu’il y a beaucoup de débats en son sein.
Nous sommes devant une bifurcation : soit les deux centres entrent en conflit, soit ils coopèrent. C’est pourquoi Claude Riveline et moi proposons la création d’une commission X-Mines qui se réunira tous les deux mois pour mieux se connaître. Chaque équipe met en discussion à tour de rôle une recherche et le débat est préparé par deux rapporteurs de l’autre équipe. Cette commission fonctionnera de nombreuses années et aidera les deux équipes à tirer un parti fécond de leurs différences.
UNE AMBIANCE START-UP
Le modèle de la start-up a envahi la communication, avec son image de jeunes mobilisés dans une démarche transgressive, des horaires de travail atypiques, des modes de financement non conventionnels et une atmosphère ludique symbolisée par des babyfoots.
Une organisation particulièrement agile
Dans notre collectif, les hiérarchies s’effacent entre les chercheurs et avec le personnel dit administratif. Nous sommes jeunes et pas encore pris dans les préoccupations de statuts. De plus le personnel “administratif” est proche de la mentalité du chercheur, en particulier Elisabeth Szuyska, dont la plume et l’intelligence la font solliciter par les chercheurs pour relire leurs textes et discuter de leurs idées. Elle deviendra progressivement la responsable financière et administrative, mais aussi la gardienne des valeurs du Centre. Elle a en particulier une intolérance absolue à la médiocrité et sait le faire sentir à ceux ou celles qui se laisseraient aller.
Le CRG ne souffre donc pas à cette époque d’une organisation en silos qu’on peut trouver même dans les petites organisations. Au-delà des réunions formelles d’échanges, chacun se tient au courant des aventures des autres, suggère des idées, discute de projets de publications, etc.
Un facteur entretient cette agilité : les travaux sur la Montagne Sainte Geneviève. Après de vifs conflits suscités avec les anciens élèves par le projet de départ de l’École à Palaiseau, Giscard d’Estaing, devenu président, a décidé de maintenir le déménagement, tout en créant un pôle économique et social sur la Montagne Saint Geneviève. L’Économétrie, le CRG et le CREA nouvellement créé par Jean-Pierre Dupuy, restent à Paris pour être intégrés dans la future création. Nous sommes ainsi seuls sur la Montagne d’août 1976 jusqu’à septembre 1978, date du lancement de l’Institut Auguste Comte. Nous avons une place immense, mais le site est dans un très mauvais état, et un grand programme de rénovation est entrepris. Au fil des travaux, nous déménageons cinq fois, ce qui nous donne un entraînement à faire nos cartons et à alléger nos archives. Et aussi à travailler au bruit des marteaux piqueurs, ce qui a sans doute entretenu notre résilience.
Travailler en jouant
Un chose frappe les visiteurs du CRG, l’ambiance ludique qui y règne. Nous avons bien mieux que les babyfoots, avec tennis, ping-pong, le billard, un beau piano demi-queue dans un amphi à la belle acoustique. La piscine de la Butte aux Cailles n’est pas loin. À cela s’ajoutent des flippers dans les cafés environnants où se livrent de belles batailles. Je viens souvent au bureau avec raquettes de tennis et de ping-pong, maillot de bain, canne de billard et partitions de piano, non pas pour pratiquer toutes ces activités pendant la journée, mais parce que je veux me laisser le choix.
À cela s’ajoute un jeu de stratégie auquel beaucoup jouent à l’heure du déjeuner, et j’entends en travaillant (je travaille beaucoup) des hurlements de rire et des protestations véhémentes de trahison, dont je ne sais pas la cause, car je ne me suis pas initié à ce jeu, à regret.
John Kimberly, qui fait une année sabbatique en 1974 en venant de la Wharton School, est dérouté par cette ambiance festive et ludique. Il me le dira plus tard, mais nous travaillons quand même beaucoup. La productivité intellectuelle du CRG est sans doute une des plus élevées de son histoire. Aucun temps n’est perdu dans des comptes à rendre, des rapports d’avancement à écrire, aucun calcul de stratégie de publication pour optimiser sa carrière. Nous sommes dans une bulle et passionnés par le projet collectif.
Je mets aussi en place un système de financement de l’équipe et de rémunération des chercheurs, lui aussi transgressif.
Un principe d’égalité
J’importe dès ma prise de fonction un système de rémunération mis au point au CGS. Les salaires des chercheurs étant très inférieurs à ceux auxquels des jeunes peuvent prétendre à la sortie des grandes écoles, il importait de diminuer ce décalage.
L’École des mines, à l’initiative de son très créatif directeur de la recherche, Pierre Laffitte, avait mis au point un système très astucieux, lui aussi transgressif, qu’il a réussi à faire valider par l’Inspection des finances et, plus tard, l’Urssaf. Les contrats négociés par les centres de recherche de l’école étaient passés avec une association loi de 1901, Armines, qui pouvait recruter des chercheurs et des administratifs, et verser des honoraires à des chercheurs des centres agréés. Ce système avait joué un rôle important au démarrage du CGS pour réduire le décalage des revenus des chercheurs avec ceux du privé et embaucher des personnes sur contrat pour se développer au-delà des moyens limités en postes dont disposait l’École des mines.
Ce système aurait toutefois posé un problème dans la gestion du CGS si le montant des honoraires avait été déterminé de manière discrétionnaire par le directeur. C’est pourquoi j’avais œuvré, avec le collectif des chercheurs, pour que soit mis en place un système faisant en sorte que la rémunération de chacun (salaires + honoraires) ne dépende que du nombre d’années après la sortie du système scolaire. C’est ainsi qu’a été déterminée une « courbe des salaires » régissant les ressources de tous, actualisée chaque année en fonction de l’inflation. Cela permettait de calculer le montant d’honoraires des titulaires de postes, et le salaire des chercheurs sur contrat.
Je propose de mettre en place ce système au CRG, ce qui est facilement accepté car améliore la situation financière de chacun. Il est par ailleurs en phase avec les idées égalitaires agitées après les événements de 1968. J’y vois un autre avantage : il évite de mesurer la qualité des uns par rapport aux autres en termes de publications ou de montant des contrats rapportés, ce qui est cohérent avec mon obsession de développer une approche pluridisciplinaire collective. Un autre avantage est aussi, bien sûr, que ce système crée une pression financière : si nous ne faisons pas assez de travaux de terrain, l’avenir des personnes sur contrat et des honoraires des autres pourrait être menacé…
Cette courbe devient rapidement ancrée dans le fonctionnement du CRG, et contribue à la solidarité de l’équipe. Quand j’ai voulu plus tard la remettre en cause pour permettre à certains de s’éloigner un moment du terrain avec un revenu moindre, ou valoriser d’autres travaillant sur des sujets à fort enjeux avec des contrats importants, j’ai dû procéder à des bricolages difficilement négociés.
L’élaboration d’une approche clinique originale
La dimension contractuelle de la recherche est porteuse de périls : manque de distance, risque de soumission aux enjeux et aux horizons de temps des entreprises, etc. Nous élaborons progressivement des réponses à ces questions.
Le CGS avait montré que la mise en œuvre de modèles permettait d’apprendre les aspects de la vie des organisations inaccessibles autrement. Sans recourir à des modèles, on pouvait accéder à une même richesse d’information, à condition que l’organisation voie un intérêt à la présence des chercheurs. Nous découvrons progressivement que c’est le cas quand elles rencontrent des problèmes préoccupants, sans être trop urgents, et dont elles peuvent confier l’analyse à des chercheurs. C’est ce qu’illustrent les premières études du CRG
Éclairer des questions importantes mais mal cernées dans l’organisation
L’étude du fonctionnement des achats chez Renault aurait certes pu être confiée à un consultant, mais le nouveau directeur de la réforme sentait sans doute que le sujet était trop sensible et a saisi l’opportunité d’une relation avec le CRG, comme une mise pour voir. L’arrivée d’un nouveau directeur des achats a créé de plus un contexte favorable à une investigation.
Un inspecteur de sûreté du CEA nous propose de mener des travaux de terrain pour éclairer les “facteurs humains” de la sécurité dans des installations nucléaires. Leurs aspects techniques sont étudiés par des armées d’ingénieurs et des règlements canalisent le comportement des opérateurs, mais le « facteur humain » est difficile à saisir, tout en jouant un rôle important. Il est demandé au CRG d’aider à y voir clair du fait de sa pluridisciplinarité. Une investigation de longue durée est ainsi menée par Denis Bayart, Jacques Girin et Paul Mayer.
Renault avait mené des expériences de remplacement du travail à la chaîne par de petites équipes « semi-autonomes ». C’était un thème à la mode pour améliorer les conditions de travail du personnel. Elles ont donné lieu localement à de bons résultats mais la question se pose de savoir jusqu’à quel point elles peuvent être généralisées. Le sujet est controversé entre les services méthodes (qui conçoivent les chaînes), les responsables d’usines, la DRH, etc., chacun invoquant des arguments techniques, économiques ou sociaux en les pondérant différemment. La question est posée de savoir si le CRG peut éclairer le sujet. Cette recherche est lancée avec Christophe Midler.
Construire une position au carrefour des demandes des acteurs
Rapidement, nous nous rendons compte qu’il ne suffit pas d’être appuyé par une personne haut placée pour que les acteurs sur le terrain dialoguent volontiers avec nous.
Ainsi, les acheteurs de Renault ne voient pas d’un bon œil ces deux jeunes envoyés par le directeur de la réforme, pour qui tout est mal organisé, et le nouveau directeur des achats qui va sûrement changer des choses. Ils énoncent des discours langue de bois sur leur stratégie d’achat. L’un tente même une intimidation : « Bonjour, XX, je connais bien ton papa tu sais, la dernière fois que je t’ai vu, tu étais un bébé sur ton coussin, avec de belles fesses roses ! » Pas de quoi le mettre en confiance … Il faut, diraient les psychanalystes, gérer le transfert des acteurs du terrain sur les chercheurs, et ce sont des sujets qui suscitent de nombreuses réflexions du CRG. Il nous faut construire une position dans l’entreprise permettant une écoute des parties prenantes, quitte à prendre une distance avec le demandeur initial.
Dans l’étude des achats, les chercheurs trouvent une ouverture. L’acheteur de vis et boulons, fonction pas très glamour, et qui ne se sent pas particulièrement menacé, donne accès aux prix d’achats de ses milliers de références. C’est alors que les chercheurs font une découverte stupéfiante : pour deux pièces semblables, ils relèvent des écarts de prix allant du simple au double ; une même référence peut être achetée chez deux fournisseurs avec des écarts de prix allant jusqu'à 30 %. En achetant tout au moins cher, on pourrait économiser 15 %.
Cela fait bondir le joie le directeur de la réforme : « Ha, ha, je l’avais dit, ce sont les écuries d’Augias ! » Le nouveau directeur des achats, choqué, se demande comment sont formés les acheteurs. Nous nous efforçons de les calmer en avançant que cela peut s’expliquer par les contraintes pesant sur l’acheteur, hypothèse qu’il faut tester en étudiant d’autres cas. Le directeur des achats nous donne accès à d’autres acheteurs, et nous trouvons toujours des résultats semblables. Nous avançons alors une explication, selon une clé de lecture proposée par Claude Riveline peu avant : les agents optimisent les critères selon lesquels ils se sentent jugés.
Un objectif est attribué chaque année aux acheteurs : ne pas dépasser telle augmentation des prix de la famille de pièces dont ils ont la charge, appelée la “dérive des prix”. Son le montant est négocié chaque année à partir de prévisions des économistes de l’entreprise. Or, malgré l’inflation imprévisible de l’époque, les acheteurs atteignent l’objectif au centième de pour cent près, faisant même mieux que les prévisions des modèles économiques. Pour cela, ils procèdent simplement :
- les pièces nouvelles n'étant pas prises en compte dans le calcul de l'indice (opération techniquement difficile), les acheteurs acceptent un prix de départ élevé pour celles-ci, en demandant au fournisseur une limitation de l’augmentation des pièces anciennes entrant dans le calcul de l'indice ; cela permet de contenir l’indice des prix, et explique les écarts de prix entre des pièces semblables mais apparues au catalogue à des dates différentes ;
- ils achètent la même référence à plusieurs fournisseurs à des prix différents (jusqu'à 30 % d'écart) et modulent la part de chacun : quand les prix montent trop vite, ils augmentent la part des fournisseurs les moins chers, et quand ils augmentent moins vite celle des fournisseurs les plus chers ; ils évitent de faire mieux que l'objectif négocié pour ne pas en avoir un plus difficile à atteindre l'année suivante.
Nous restituons cette analyse. Le directeur de la réforme persiste dans son idée des écuries d’Augias, mais le directeur des achats souhaite approfondir la question, et nous pouvons ainsi analyser les ramifications de ces dispositifs de gestion, en allant à la rencontre d’autres acteurs[2][3]. Au fil des années, nous précisons la manière de construire une relation équilibrée avec tous les acteurs, et proposons des dispositifs de travail assez élaborés[4].
Des contrats sans engagements de résultats
Ces études donnent lieu à contrats, mais avec des règles précises.
Nous refusons de nous engager sur les méthodes que nous utiliserons, sur les résultats et les délais, pour garder notre liberté d’investigation. Nous nous engageons en revanche sur les moyens engagés pour étudier le problème qu’on nous confie. Nous présentons régulièrement l’avancement de nos travaux à une instance comprenant le demandeur et les parties prenantes découvertes au fil de l’investigation. Nous discutons de tout : méthodes suivies, découvertes, hypothèses, investigations envisagées. Nous rédigeons un compte rendu et le diffusons selon des modalités convenues. Cette transparence sur le déroulement de l’étude est un moyen de gérer notre liberté : si le demandeur avait une intention cachée, il est obligé de l’expliciter, ce qui limite ses ardeurs. De plus, le fait d’expliciter nos analyses peut amener des acteurs à signaler des points qui manquent, ce qui aide à compléter nos investigations.
Nous posons l’exigence de publier les résultats de nos investigations, en montrant (et non pas en soumettant) à l’avance les projets de publication afin de discuter de la manière de préserver la confidentialité de certaines informations. Enfin, nous refusons des délais précis avec remise de « livrables », mais convenons d’une durée, souvent un an, au terme de laquelle nous faisons le point, et pouvons décider de continuer. Ces études durent en effet souvent deux ou trois ans, parfois plus.
Ce mode de relation diffère fortement des contrats négociés par les consultants, et sa mise en place demande parfois de longues explications, mais elle est la condition impérative pour engager la relation.
Gérer la prise de recul
Lorsqu’on travaille en relation étroite avec un terrain, on risque de manquer de distance et d’intérioriser les évidences de partenaires avec lesquels on interagit. On peut être aussi plus à l’écoute, consciemment ou non, de ceux qui facilitent la tâche que de ceux qui y font obstacle.
La mise à distance passe par le dialogue. Dialogue dans les réunions plénières du CRG lorsque l’étude des chercheurs est à l’ordre du jour : qu’est-ce qui te fait dire cela ? Tu accordes trop d’importance au point de vue d’untel. Tu devrais mieux étayer ce point de vue, etc. Ce sont des moyens de cette prise de recul. Celle-ci passe aussi par des échanges dans mon bureau. Par exemple, le débriefing de la remarque de l’acheteur renvoyant le chercheur sur son petit coussin relève plutôt d’un échange en tête-à-tête que collectif.
Cela situe l’importance du travail collectif : non seulement c’est un moyen d’exercer la pluridisciplinarité et de mettre en commun des observations pour faire émerger des concepts transversaux, mais aussi d’aider à garder la distance qui sied à la recherche. C’est pourquoi j’ai défendu avec constance, parfois acharnement, ce travail collectif.
Les idées folles
Ce positionnement est à l’époque très singulier et il arrive aussi que les demandes qui nous sont adressées soient elles-mêmes décalées par rapport à l’idée qu’on se fait d’engager une recherche.
La proposition d’étudier les achats chez Renault était déraisonnable du fait du décalage entre les enjeux et l’expérience des jeunes. Celle du CEA aussi, dans la mesure où la notion de facteurs humains est vague, et peu de terrains mûrs pour engager un tel travail. Il faut d’ailleurs des mois de négociation pour accéder à un premier terrain, si complexe et avec une si grande variété de matériaux radioactifs que les inspecteurs de la sécurité n’ont pas encore osé y faire des contrôles. Les chercheurs sont même bienvenus car le personnel se sent délaissé. Mais l’idée la plus folle est proposée quatre ans après la création du CRG.
La folle aventure des Chroniques Muxiennes
En 1979, Marie-Josèphe Carrieu Costa et Jean-François Millat, d'EDF, me font une proposition étrange. Après la vogue suscitée par la publication du rapport Nora-Minc L'informatisation de la société, EDF redoute que le gouvernement ne prenne EDF comme terrain d’expérimentation (on approche des élections). Il faut montrer qu’EDF se prépare à la télématique. Mes interlocuteurs ont l’idée de créer un groupe de cadres d'EDF qui élaborera des scénarios mettant en scène l'usage chez EDF de la "télématique" pour lancer ensuite des discussions participatives (c’est à la mode). Il est proposé au CRG d'animer la réflexion du groupe de cadres et de rédiger des scénarios "zéro".
Je suis réticent. Je ne suis pas sûr que la fiction soit un genre dans lequel nous pouvons exceller. De plus, la voie choisie par le CRG déroute à l'École polytechnique, nous le verrons, et je me vois mal claironner que nous nous lançons dans la science-fiction. J'informe toutefois le CRG de cette proposition et trois chercheurs se portent candidats avec enthousiasme, Jacques Girin, Vincent Dégot et Christophe Midler. Notre esprit start-up nous pousse à nous lancer, et les trois compères passent l'été à travailler dans l’euphorie sur les scénarios zéro. L’atmosphère va vite changer.
Des scénarios (trop) électriques
La présentation des scénarios au groupe de cadres se passe très mal. Il demande qu’un scénario, Soirée électrique, de Jacques Girin, soit détruit car il met en scène un monde où les individus sont traqués par les machines, et les relations des clients avec EDF épouvantables. Il est certes écrit d'une plume légère censée adoucir le propos, mais que des cadres d’EDF puissent imaginer, et plus encore écrire, de telles horreurs ferait scandale. Les autres scénarios heurtent moins mais soulèvent des questions que le groupe pensent plus prudent d'occulter. Nous discutons d’autres scénarios. Envisageons-nous que la télématique augmente la centralisation ? Non, cela irait contre les orientations de la direction générale. Mettrons-nous en scène une forte décentralisation ? La direction générale n'a pas fixé sa doctrine. Écrirons-nous que rien ne changerait ? Cela ne ferait pas sérieux…
Après trois mois de piétinements se tient une réunion de crises, et l’un de nous (je ne sais plus qui) avance l'idée d'inventer un pays imaginaire, la Muxie, où se dérouleraient les événements. On y aurait découvert des réserves considérables de pétrole et le gouvernement chargerait EDM (Électricité de Muxie) d'orchestrer le développement du pays en utilisant les moyens télématiques pour faire de la Muxie un pays en pointe mondiale.
La pensée joyeuse
Le procédé marche au-delà des espérances. Dès la première réunion, les membres du groupe demandent : "J'espère que vous n'avez pas détruit le scénario Soirée électrique ! Chez EDF, ce n'est pas possible, mais en Muxie c'est sûr !" Il est retenu tel quel. Tous les autres sujets deviennent pensables et le groupe fait œuvre de créativité. Quatre autres scénarios sont écrits dans un dialogue joyeux. Un télécran pour deux met en scène de nouvelles modalités de coopération entre un cadre et sa secrétaire, et la panique qui saisit celles qui ne maîtrisent pas les outils. Télécollégialité met en scène les modifications des structures de pouvoir induites par la généralisation des téléréunions. La revanche de Mademoiselle Vanos montre une vieille institutrice très respectée au village mais dont l'aura est menacée par son manque de maîtrise les nouvelles technologies. Surtension au télébureau décrit une confusion créée par le travail à distance : des personnes se mettent en grève par solidarité avec des voisins licenciés par une autre entreprise, dont ils se sentent solidaires ; on ne sait plus avec qui ni sur quoi négocier.
Rires et chuchotements
Les scénarios, une fois validés, doivent être publiés chez EDF pour nourrir une concertation interne, mais tout nous échappe. Les secrétaires qui tapent ces textes s’en amusent et font des photocopies qui circulent. Elles en parlent aux vendeurs d'IBM qui viennent changer les boules de leurs machines à écrire, et ceux-ci s’empressent de donner ces scénarios à d'autres, notamment à la Délégation générale des télécommunications (DGT), en première ligne sur le front de la télématique. La DGT, en fait même un exemple pour ses cadres : "EDF nous apprend notre métier ..." Cela n'inquiète pas trop les auteurs, flattés même que leur prose suscite un tel engouement. Jusqu'au jour où paraît le 22 avril 1981, dans le Canard Enchaîné, juste avant les élections présidentielles …
Une affaire publique
… un article incendiaire "Des technocrates survoltés". L'auteur dit s'être procuré un projet de rapport circulant sous le manteau, dans lequel des cadres d'EDF avec la complicité de chercheurs de l'École polytechnique, préparent "un monde entièrement électronisé et plutôt lugubre dont les auteurs futurologues nous disent qu'ils ont déjà les moyens de nous le préparer".
Aussitôt a direction générale d'EDF décide de ne pas diffuser le rapport. Je fais valoir que le censurer risque d'accréditer la thèse du Canard et il est convenu de publier l'ouvrage chez un éditeur indépendant. Cela n'engagerait pas officiellement EDF. Il ne paraît finalement qu'en septembre 1982[5], mais des photocopies continuent de circuler. Quelques temps plus tard Témoignages chrétiens publie Soirée électrique. "C'est le premier d'une série de cinq scénarios commandés par la 'Division Etudes' du 'Service de l'Information et des Relations Publiques' d'EDF aux gens fort sérieux et compétents du 'Centre de Recherche en Gestion de l'École polytechnique' (…) Toutes les technologies envisagées (…) sont connues et déjà expérimentées ici ou là".
C’est un tourbillon. On se saisit des Chroniques pour conforter ses espoirs ou ses craintes. Les auteurs sont invités au festival du film scientifique de 1982 où est présenté un film reprenant les Chroniques dans lequel l'acteur principal est Fabrice Luchini pour un de ses premiers films. Il obtient le premier prix. Les Chroniques deviennent une affaire publique : la presse spécialisée s'en saisit, les conférences se multiplient, nous sommes invités à une pièce de théâtre sur les Chroniques créée à Sophia Antipolis.
Cette folle aventure fait largement connaître le CRG, et cela fait même bon effet à l’École polytechnique. Chez EDF est créé un groupe de travail sur l’organisation du bureau, et c’est la première fois que les secrétaires en à parité avec leurs patrons. Jacques Girin écrit un superbe article : « L’ambiguïté créatrice ». On sait aujourd’hui que le recours à la science-fiction est un bon moyen de réfléchir sur des futurs incertains, mais à l’époque il fallait être fou pour se lancer dans l’aventure.
Les premières publications dans des revues
Progressivement, les chercheurs publient dans des revues autres que les siennes des articles qui retiennent l’attention. Toutefois nous publions plus facilement dans des revues de sociologie (du travail notamment), de psychosociologie, de systémique que de gestion. Les académiques s’y perdent un peu, surtout s’ils veulent nous évaluer. Nous verrons que cela a constitué un sérieux problème quand il nous a fallu demander la reconnaissance du CNRS en 1981.
Une magnifique occasion se présente toutefois en 1980, avec la proposition des Annales des mines de réaliser un numéro spécial sur la recherche en gestion vue par le CRG, qui ferait écho à un numéro Économie d’entreprise réalisé par le CGS en 1977. J’accepte avec enthousiasme et nous travaillons plusieurs mois à la réalisation d’un numéro affirmant une pratique nouvelle de recherche.
Il paraît en juillet-août 1981 avec le titre Recherche en gestion, les analyses du Centre de recherche en gestion de l’École polytechnique. On le trouvera sur le site du CRG. J’en suis particulièrement content, et ce sentiment me semble partagé par tous, car il montre la cohérence du CRG et en même temps son ouverture à une diversité d’approches. Il est de plus mentionné que le CRG est associé au CNRS, ce qui signifie une reconnaissance officielle importante.
Cette description d’une ascension déterminée et joyeuse, avec ce qui semble un aboutissement heureux, donne toutefois une vision tronquée de la trajectoire du CRG. Entre 1975 et 1981, il a en effet subi plusieurs coups de Trafalgar. J’ai ainsi appris que l’institutionnalisation du CRG allait être un sport de combat, ce que j’étais loin de soupçonner en donnant mon accord à Bertrand Collomb.
Prochain épisode : la bataille de l’institutionnalisation
[1] Il m’apprendra l’art de rencontrer des gens « par hasard ». Ainsi, pour me faire connaître Philippe Agid, patron de la FNEGE, il me propose de me trouver à telle heure en tel lieu, et passant par là en revenant d’un déjeuner avec lui, il dit « Michel, cela tombe bien je te présente Philippe Agid ».
[2] Pour connaître la suite des investigations, on pourra voir Gérard de Pouvourville « Volonté de changement et cohérence organisationnelle. Comment modifier les politiques d'achat des grandes entreprises ? » Annales des mines, juin 1981, ou Michel Berry, Une technologie invisible ? Publication École polytechnique, juin 1983.
[3] On pourra s’étonner que je reprenne si souvent cet exemple alors que nous avons mené des dizaines d’études. C’est pour ses vertus pédagogiques, car il choque en quelques mots les personnes imprégnées d’une vision économique classique, c’est à dire à peu près tout le monde.
[4] Michel Berry, “Research and the Practice of Management : A French View”, Organization Science, Jan. - Feb., 1995, Vol. 6, No. 1,
[5] Vincent Dégot, Jacques Girin, Christophe Midler, Chroniques Muxiennes, La télématique au quotidien, Éditions Entente, collection Vivre demain, 1982