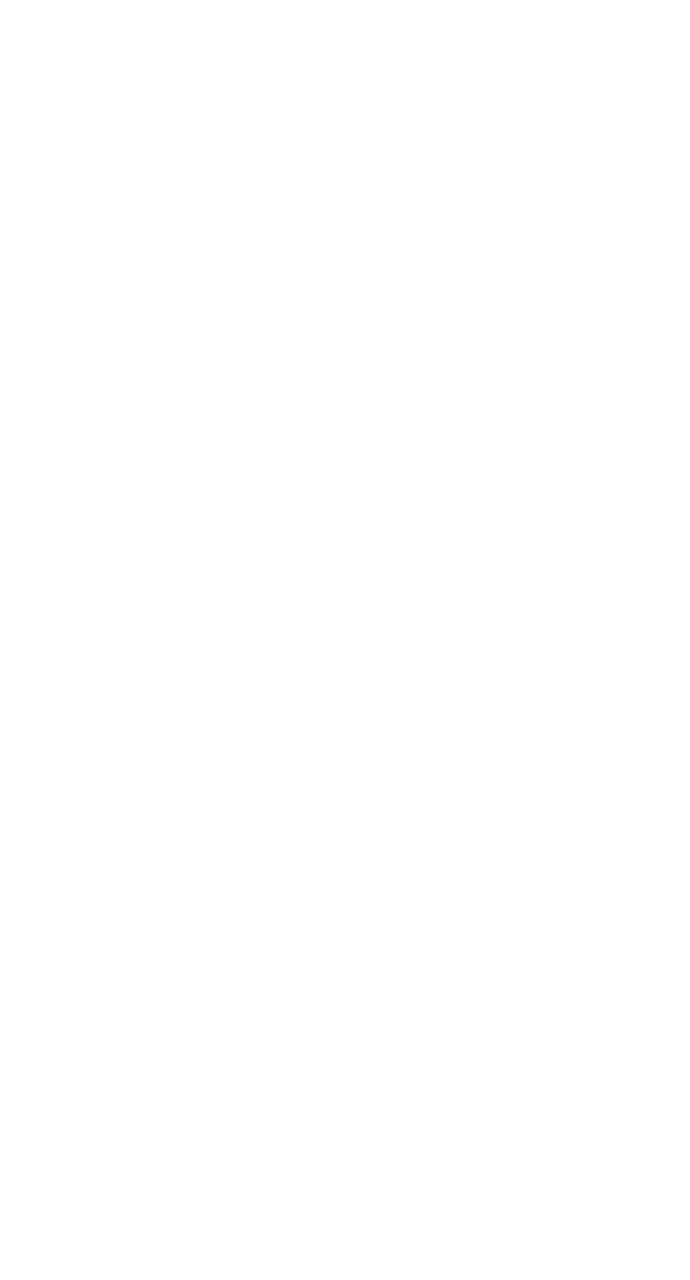29 mars 2016
Karim Basbous coordonne le colloque "Le beau et le laid"
organisé par la Société française des architectes en partenariat avec le CNRS (GDRI « Savoirs artistiques et traités d’art »)
Ce colloque aura lieu dans les locaux de la Société française des architectes
247, rue St Jacques, 75005 Paris
(entrée libre et gratuite)
vendredi 27 et samedi 28 mai 2016
Groupe de recherche international "Savoirs artistiques et traités d’art".
Le beau et le laid
Ces deux mots habitent notre quotidien, pour qualifier à peu près tout. Le monde bâti n’y a pas échappé : l’architecture a beaucoup eu affaire avec le beau, et, par opposition, avec le laid, bien que cette relation ait été moins explicitée. Les autres arts tels que la peinture, la musique, le cinéma, mais aussi la mode, ont-ils vécu les mêmes aventures avec ces notions à la fois savantes et communes ? A quels savoirs, concepts ou principes s’adosse-t-on lorsqu’on use de ces adjectifs ?
De l’Antiquité à nos jours, comment le beau et le laid ont-ils contribué à faire le tri des oeuvres ? Quelle relation au style, au goût, à la faculté de juger, ces notions entretiennent-elles ? Dans quelle mesure peuvent-elles cohabiter dans une même oeuvre bâtie ? Le beau et le laid se tournent-ils le dos, ou se regardent-ils parfois ?
Comment ces critères parviennent-ils à s’adapter aux oeuvres bâties d’échelles variées, allant des jardins aux paysages, en passant par les villes et les quartiers ? Ils traversent aussi l’architecture, de l’appartement au musée, du détail au plan. Hors la beauté graphique, peut-on parler d’un beau plan ou d’une belle coupe ? Par ailleurs, les objets demeurent, mais le regard que l’on porte sur eux évolue : l’histoire est riche de revirements par lesquels telle oeuvre se voit déchue, tandis qu’une autre gagne peu à peu les faveurs du public ; ce fut le cas notamment de la tour Eiffel et du Centre Pompidou, que l’on a appris à aimer.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, il sera question dans ce colloque de ce que signifient le beau et le laid aujourd’hui.
De l’Antiquité à nos jours, comment le beau et le laid ont-ils contribué à faire le tri des oeuvres ? Quelle relation au style, au goût, à la faculté de juger, ces notions entretiennent-elles ? Dans quelle mesure peuvent-elles cohabiter dans une même oeuvre bâtie ? Le beau et le laid se tournent-ils le dos, ou se regardent-ils parfois ?
Comment ces critères parviennent-ils à s’adapter aux oeuvres bâties d’échelles variées, allant des jardins aux paysages, en passant par les villes et les quartiers ? Ils traversent aussi l’architecture, de l’appartement au musée, du détail au plan. Hors la beauté graphique, peut-on parler d’un beau plan ou d’une belle coupe ? Par ailleurs, les objets demeurent, mais le regard que l’on porte sur eux évolue : l’histoire est riche de revirements par lesquels telle oeuvre se voit déchue, tandis qu’une autre gagne peu à peu les faveurs du public ; ce fut le cas notamment de la tour Eiffel et du Centre Pompidou, que l’on a appris à aimer.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, il sera question dans ce colloque de ce que signifient le beau et le laid aujourd’hui.
VENDREDI 27 MAI
Matin
10h00
Juan José Lahuerta
L’éclipse. De la laideur de l’art moderne dans l’oeuvre
de Hans Sedlmayr
10h30
Bruno Reichlin
Méfions-nous du beau
11h00
Séance de questions et débat
11h30
Guillemette Morel Journel
Modernité et beauté
12h00
Olivier Gahinet
Comme l’Antique
12h30
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Après-midi
14h30
Philippe Rivoirard
Du beau, du bon et du laid
15h00
Pierre Fauroux
L’orage sur le toit
16h00
Bruno Marchand
L’étrange, à la lisière
entre le beau et le laid
16h30
Séance de questions et débat
17h00
Pause
17h30
Jean-Claude Laisné
L’altération comme projet.
Le beau est tombé du ciel pour finir dans un coffre
18h00
Georges Vigarello
Les transformations du corps
et de la beauté
18h30
Séance de questions et débat
Matin
10h00
Juan José Lahuerta
L’éclipse. De la laideur de l’art moderne dans l’oeuvre
de Hans Sedlmayr
10h30
Bruno Reichlin
Méfions-nous du beau
11h00
Séance de questions et débat
11h30
Guillemette Morel Journel
Modernité et beauté
12h00
Olivier Gahinet
Comme l’Antique
12h30
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Après-midi
14h30
Philippe Rivoirard
Du beau, du bon et du laid
15h00
Pierre Fauroux
L’orage sur le toit
16h00
Bruno Marchand
L’étrange, à la lisière
entre le beau et le laid
16h30
Séance de questions et débat
17h00
Pause
17h30
Jean-Claude Laisné
L’altération comme projet.
Le beau est tombé du ciel pour finir dans un coffre
18h00
Georges Vigarello
Les transformations du corps
et de la beauté
18h30
Séance de questions et débat
SAMEDI 28 MAI
Matin
10h00
Baldine Saint Girons
L’utilité de l’architecture :
un problème majeur pour l’esthétique à l’état naissant
10h30
Mona Chollet
Beauté de chair,
beauté de pierre
11h00
Séance de questions et débat
11h30
Yves Hersant
Grâce et beauté :
un couple conflictuel ?
12h00
Jean-Philippe Domecq
Pourquoi on ne peut plus dire « beau », et ce qu’on pourrait bien mettre à la place
12h30
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Après-midi
14h30
Marie-José Mondzain
« Un tas d'ordures assemblées au hasard : le plus bel ordre du monde »
15h00
Monique Mosser
Le grand n’importe quoi
de la « nature en ville »
16h00
Karim Basbous
L’architecture sans gravité
16h30
Séance de questions et débat
17h00
Pause
17h30
Franco Purini
L’art du meilleur
18h00
François-Frédéric Muller
La nouvelle jeunesse de la ruine
18h30
Séance de questions et débat
Des modifications pourraient survenir après la rédaction du présent programme,
nous vous invitons à consulter la mise à jour sur notre site internet : www.sfarchi.org
Matin
10h00
Baldine Saint Girons
L’utilité de l’architecture :
un problème majeur pour l’esthétique à l’état naissant
10h30
Mona Chollet
Beauté de chair,
beauté de pierre
11h00
Séance de questions et débat
11h30
Yves Hersant
Grâce et beauté :
un couple conflictuel ?
12h00
Jean-Philippe Domecq
Pourquoi on ne peut plus dire « beau », et ce qu’on pourrait bien mettre à la place
12h30
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Après-midi
14h30
Marie-José Mondzain
« Un tas d'ordures assemblées au hasard : le plus bel ordre du monde »
15h00
Monique Mosser
Le grand n’importe quoi
de la « nature en ville »
16h00
Karim Basbous
L’architecture sans gravité
16h30
Séance de questions et débat
17h00
Pause
17h30
Franco Purini
L’art du meilleur
18h00
François-Frédéric Muller
La nouvelle jeunesse de la ruine
18h30
Séance de questions et débat
Des modifications pourraient survenir après la rédaction du présent programme,
nous vous invitons à consulter la mise à jour sur notre site internet : www.sfarchi.org
VENDREDI 27 MAI
10h00
Juan José Lahuerta
École technique supérieure d'architecture de Barcelone
L’éclipse. De la laideur de l’art moderne dans l’oeuvre de Hans Sedlmayr
Accuser l’art et l’architecture modernes d’être un symptôme, mais aussi l’une des causes de la perte des valeurs morales du monde contemporain, faire de leur « laideur » le reflet direct de cette perte de valeurs, de la démoralisation dans laquelle sont tombées non seulement la culture, mais toute la vie européenne : telle est la critique de l’historien de l’art Hans Sedlmayr (1896-1984), toujours formulée du point de vue du pessimisme le plus radical et de la négativité la plus absolue. Avant d’être relativement oubliée, l’oeuvre de Sedlmayr a bénéficié d’une grande renommée non seulement dans les cercles universitaires, mais aussi auprès du grand public, grâce à une série de livres à succès publiés après la Seconde Guerre mondiale. Leurs titres sont éloquents – La perte du centre, La mort de la lumière – et on y trouve nombre d’invectives contre l’art et l’architecture modernes, où les mots « décadence », « dissolution », « perte », « laideur », « mort », « éclipse », et « refroidissement » visent à considérer la modernité comme une apocalypse, ou du moins une descente aux enfers.
Pourquoi une telle obstination à l’encontre de l’art moderne ? Pourquoi cette obsession de ce qui serait sa laideur démoniaque ? Je propose de comprendre le sens politique et idéologique de l’oeuvre de Sedlmayr, et d’expliquer sa popularité en Europe et dans l’Amérique de l’après-guerre.
Juan José Lahuerta
École technique supérieure d'architecture de Barcelone
L’éclipse. De la laideur de l’art moderne dans l’oeuvre de Hans Sedlmayr
Accuser l’art et l’architecture modernes d’être un symptôme, mais aussi l’une des causes de la perte des valeurs morales du monde contemporain, faire de leur « laideur » le reflet direct de cette perte de valeurs, de la démoralisation dans laquelle sont tombées non seulement la culture, mais toute la vie européenne : telle est la critique de l’historien de l’art Hans Sedlmayr (1896-1984), toujours formulée du point de vue du pessimisme le plus radical et de la négativité la plus absolue. Avant d’être relativement oubliée, l’oeuvre de Sedlmayr a bénéficié d’une grande renommée non seulement dans les cercles universitaires, mais aussi auprès du grand public, grâce à une série de livres à succès publiés après la Seconde Guerre mondiale. Leurs titres sont éloquents – La perte du centre, La mort de la lumière – et on y trouve nombre d’invectives contre l’art et l’architecture modernes, où les mots « décadence », « dissolution », « perte », « laideur », « mort », « éclipse », et « refroidissement » visent à considérer la modernité comme une apocalypse, ou du moins une descente aux enfers.
Pourquoi une telle obstination à l’encontre de l’art moderne ? Pourquoi cette obsession de ce qui serait sa laideur démoniaque ? Je propose de comprendre le sens politique et idéologique de l’oeuvre de Sedlmayr, et d’expliquer sa popularité en Europe et dans l’Amérique de l’après-guerre.
10h30
Bruno Reichlin
Université de Genève
Méfions-nous du beau
Les notions de beau et le laid me semblent confrontées aujourd’hui à un obstacle épistémologique lié aux qualités ontologiques que nous attribuons aux objets qui sont devant nous. En effet, pour apprécier l’art moderne et contemporain l’observateur doit fournir un effort herméneutique qui fait appel à son propre bagage culturel. L’oeuvre propose mais l’observateur, sur la base de sa culture et de ses compétences critiques, dispose : il procède à une sorte de re-création.
Par ailleurs je refuse l’idée, souvent associée à la notion de beau, d’une scission entre le sensible – qui serait l’apanage des instinctifs soumis aux coups de foudre – et l’intelligible – réservé quant à lui aux intellectuels. Car le contexte a changé. Nous ne devrions plus être tiraillés entre une vision savante, philologique et intertextuelle, de l’oeuvre, et une posture quasi religieuse de sacralisation de l’art. A cet égard, un des rites de conversion du spectateur est l’exposition – dont nous examinerons quelques exemples.
Jean Dubuffet écrivait en mai 1968 (tiens donc !) dans le pamphlet Asphyxiante Culture: « Beau vient en droite ligne du chant des anges, du buisson ardent – dont le professeur Chastel, en robe étoilée, révèle à la Sorbonne, entouré de ses servants, le dogme inaltérable (avec la férule) ». Le beau contre la science ?
11h00
Séance de questions et débat
Bruno Reichlin
Université de Genève
Méfions-nous du beau
Les notions de beau et le laid me semblent confrontées aujourd’hui à un obstacle épistémologique lié aux qualités ontologiques que nous attribuons aux objets qui sont devant nous. En effet, pour apprécier l’art moderne et contemporain l’observateur doit fournir un effort herméneutique qui fait appel à son propre bagage culturel. L’oeuvre propose mais l’observateur, sur la base de sa culture et de ses compétences critiques, dispose : il procède à une sorte de re-création.
Par ailleurs je refuse l’idée, souvent associée à la notion de beau, d’une scission entre le sensible – qui serait l’apanage des instinctifs soumis aux coups de foudre – et l’intelligible – réservé quant à lui aux intellectuels. Car le contexte a changé. Nous ne devrions plus être tiraillés entre une vision savante, philologique et intertextuelle, de l’oeuvre, et une posture quasi religieuse de sacralisation de l’art. A cet égard, un des rites de conversion du spectateur est l’exposition – dont nous examinerons quelques exemples.
Jean Dubuffet écrivait en mai 1968 (tiens donc !) dans le pamphlet Asphyxiante Culture: « Beau vient en droite ligne du chant des anges, du buisson ardent – dont le professeur Chastel, en robe étoilée, révèle à la Sorbonne, entouré de ses servants, le dogme inaltérable (avec la férule) ». Le beau contre la science ?
11h00
Séance de questions et débat
11h30
Guillemette Morel Journel
Observatoire de la condition suburbaine / ENSA VT de Marne-la-Vallée
Modernité et beauté
La catégorie du « beau » n’est guère de mise dans les arts et l’architecture d’aujourd’hui. Il y eut pourtant un épisode de l’histoire de l’architecture où un architecte s’est emparé de la beauté pour en faire frontalement un enjeu de la modernité, et ce au péril de sa réputation. En 1929, Le Corbusier répondit à ses détracteurs de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité), qui l’accusaient d’avoir conçu un projet académique pour le Mundaneum, par un long texte significativement intitulé « Défense de l’architecture ». Un des slogans les plus marquants en était : « L’utile n’est pas le beau. »
En n’hésitant pas à affronter de plein fouet l’ire de ses compagnons de route, Le Corbusier affirme que la beauté transcende les postures idéologiques et formalistes et garde, quels que soient les styles par lesquels elle est exprimée, une pertinence au coeur même du projet moderne. A priori, le Carpenter Center paraît informe, voire laid. La beauté moderne est-elle une question de forme ou de fonction, ou plutôt une question de posture ?
Une lecture minutieuse de la « Défense de l’architecture », et de quelques autres textes jusqu’à son « testament » de 1960 (L’Atelier de la recherche patiente) nous aide à comprendre une association qui pour tant d’autres demeure un paradoxe : beauté et modernité.
Guillemette Morel Journel
Observatoire de la condition suburbaine / ENSA VT de Marne-la-Vallée
Modernité et beauté
La catégorie du « beau » n’est guère de mise dans les arts et l’architecture d’aujourd’hui. Il y eut pourtant un épisode de l’histoire de l’architecture où un architecte s’est emparé de la beauté pour en faire frontalement un enjeu de la modernité, et ce au péril de sa réputation. En 1929, Le Corbusier répondit à ses détracteurs de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité), qui l’accusaient d’avoir conçu un projet académique pour le Mundaneum, par un long texte significativement intitulé « Défense de l’architecture ». Un des slogans les plus marquants en était : « L’utile n’est pas le beau. »
En n’hésitant pas à affronter de plein fouet l’ire de ses compagnons de route, Le Corbusier affirme que la beauté transcende les postures idéologiques et formalistes et garde, quels que soient les styles par lesquels elle est exprimée, une pertinence au coeur même du projet moderne. A priori, le Carpenter Center paraît informe, voire laid. La beauté moderne est-elle une question de forme ou de fonction, ou plutôt une question de posture ?
Une lecture minutieuse de la « Défense de l’architecture », et de quelques autres textes jusqu’à son « testament » de 1960 (L’Atelier de la recherche patiente) nous aide à comprendre une association qui pour tant d’autres demeure un paradoxe : beauté et modernité.
12h00
Olivier Gahinet
ENSA de Strasbourg
Comme l’Antique
En 1886, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit : « — Voilà qui est fâcheux ! C’est toujours la vieille histoire ! Lorsque l’on a fini de se bâtir sa maison, on s’aperçoit soudain qu’en la bâtissant on a appris quelque chose qu’on aurait dû savoir avant de… commencer. L’éternel et douloureux "trop tard !" — La mélancolie de tout achèvement ! — ».
L’architecte, lui, anticipe. C’est son métier : il projette. C’est ce que fait, en 1914, Charles-Édouard Jeanneret (né un an après la publication du texte de Nietzsche) quand il invente un système d’ossature en béton qui doit permettre le construction en série de maisons à bon marché. Cette ossature – qu’il a baptisée Dom-ino – sera publiée en 1930, début du premier tome de ses OEuvres Complètes. Celui qui est devenu Le Corbusier écrit alors qu’elle aura attendu quinze ans pour se voir utilisée, dans le projet des maisons dites « Loucheur » (1929).
En réalité, le schéma de cette ossature, ce dessin qui ouvre le premier tome des OEuvres Complètes et va connaître une immense fortune critique parmi les historiens de l’architecture, représente pour tous les projets puristes « ce qu’il faut savoir avant de commencer », pour reprendre les termes de Nietzsche. On verra que la plupart des projets puristes explorent des thèmes posés par l’ossature Dom-ino et qui vont bien au-delà de l’ossature ; il faudra longtemps à Le Corbusier pour en faire le tour, et ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, à la villa Shodhan, qu’il en sortira, littéralement, par le haut. Entre-temps, le petit dessin des maisons Dom-ino aura joué dans son oeuvre – et dans une bonne part du Mouvement moderne – le même rôle que le temple grec pour les architectes du XIXe siècle : c’est un objectif et un garant pour s’assurer que le bon est, aussi, le beau.
Olivier Gahinet
ENSA de Strasbourg
Comme l’Antique
En 1886, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit : « — Voilà qui est fâcheux ! C’est toujours la vieille histoire ! Lorsque l’on a fini de se bâtir sa maison, on s’aperçoit soudain qu’en la bâtissant on a appris quelque chose qu’on aurait dû savoir avant de… commencer. L’éternel et douloureux "trop tard !" — La mélancolie de tout achèvement ! — ».
L’architecte, lui, anticipe. C’est son métier : il projette. C’est ce que fait, en 1914, Charles-Édouard Jeanneret (né un an après la publication du texte de Nietzsche) quand il invente un système d’ossature en béton qui doit permettre le construction en série de maisons à bon marché. Cette ossature – qu’il a baptisée Dom-ino – sera publiée en 1930, début du premier tome de ses OEuvres Complètes. Celui qui est devenu Le Corbusier écrit alors qu’elle aura attendu quinze ans pour se voir utilisée, dans le projet des maisons dites « Loucheur » (1929).
En réalité, le schéma de cette ossature, ce dessin qui ouvre le premier tome des OEuvres Complètes et va connaître une immense fortune critique parmi les historiens de l’architecture, représente pour tous les projets puristes « ce qu’il faut savoir avant de commencer », pour reprendre les termes de Nietzsche. On verra que la plupart des projets puristes explorent des thèmes posés par l’ossature Dom-ino et qui vont bien au-delà de l’ossature ; il faudra longtemps à Le Corbusier pour en faire le tour, et ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, à la villa Shodhan, qu’il en sortira, littéralement, par le haut. Entre-temps, le petit dessin des maisons Dom-ino aura joué dans son oeuvre – et dans une bonne part du Mouvement moderne – le même rôle que le temple grec pour les architectes du XIXe siècle : c’est un objectif et un garant pour s’assurer que le bon est, aussi, le beau.
12h30
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Pause déjeuner
14h30
Philippe Rivoirard
ENSA de Paris-Val de Seine
Du beau, du bon et du laid
Cette antinomie pourrait être le titre d'un nouveau roman de Jane Austen, après Raison et Sentiments, ou Orgueil et Préjugés, ou bien celui d'un sixième volume de l'Histoire des passions françaises de Théodore Zeldin – le troisième était intitulé Goût et corruption. Depuis Platon, la beauté représente un idéal – kalos kagathos – au même titre que la bonté : c'est d'ailleurs en grec le même mot, à la différence du russe, pour lequel tout ce qui est rouge est beau.
Tout serait simple alors dans notre civilisation gréco-latine, et peut-être même ennuyeux, si le diable et sa beauté ne s'étaient pas introduits quelques siècles plus tard.
La beauté du diable (depuis Faust) : jeunesse, séduction, tentation, transgression, perversité, autant de « qualités » qui permettent également de toucher à la beauté. A quel prix ? Tous les soirs, Dorian Gray observe l'évolution de son portrait, envahi par la laideur.
Et pourtant, « La beauté des laids se voit sans délai » chantait Serge Gainsbourg, qui s'y connaissait en paradoxes.
La laideur pourrait-elle être également un facteur de beauté ? Le regard que l'on porte sur Quasimodo de Notre-Dame de Paris semble le montrer, auquel cas l'antinomie proposée n'en serait plus une, et serait plutôt une question de regard.
Philippe Rivoirard
ENSA de Paris-Val de Seine
Du beau, du bon et du laid
Cette antinomie pourrait être le titre d'un nouveau roman de Jane Austen, après Raison et Sentiments, ou Orgueil et Préjugés, ou bien celui d'un sixième volume de l'Histoire des passions françaises de Théodore Zeldin – le troisième était intitulé Goût et corruption. Depuis Platon, la beauté représente un idéal – kalos kagathos – au même titre que la bonté : c'est d'ailleurs en grec le même mot, à la différence du russe, pour lequel tout ce qui est rouge est beau.
Tout serait simple alors dans notre civilisation gréco-latine, et peut-être même ennuyeux, si le diable et sa beauté ne s'étaient pas introduits quelques siècles plus tard.
La beauté du diable (depuis Faust) : jeunesse, séduction, tentation, transgression, perversité, autant de « qualités » qui permettent également de toucher à la beauté. A quel prix ? Tous les soirs, Dorian Gray observe l'évolution de son portrait, envahi par la laideur.
Et pourtant, « La beauté des laids se voit sans délai » chantait Serge Gainsbourg, qui s'y connaissait en paradoxes.
La laideur pourrait-elle être également un facteur de beauté ? Le regard que l'on porte sur Quasimodo de Notre-Dame de Paris semble le montrer, auquel cas l'antinomie proposée n'en serait plus une, et serait plutôt une question de regard.
15h00
Pierre Fauroux
ENSA de Marseille-Luminy
L’orage sur le toit
L’orage sur le toit !
Et que fait l’eau ?
Dans la nature, elle va se frayer son chemin en nous offrant des beautés naturelles : sources, torrents, cascades, lacs, …. Mais l’homme intervient. Pour la maitriser et mieux l’utiliser il crée des ouvrages remarquables et souvent grandioses : des citernes et des barrages pour la stocker, des aqueducs pour la transporter, des fontaines pour l’admirer.
Dans les bâtiments, pour s’en préserver, selon le climat et les matériaux, vont apparaître toutes sortes de solutions, des plus simples aux plus ingénieuses, des plus belles aux plus originales.
Aujourd’hui « l’orage est sur le toit » des nouvelles constructions avec toujours les mêmes problèmes : se protéger, réceptionner, canaliser, évacuer ou récupérer. Des solutions, les artisans ou architectes n’ont rien inventé. Certains, utilisant au mieux les nouveaux matériaux ou les nouvelles technologies, ont su les interpréter ou les réinventer.
Pour certains, car pour les autres ….
Pierre Fauroux
ENSA de Marseille-Luminy
L’orage sur le toit
L’orage sur le toit !
Et que fait l’eau ?
Dans la nature, elle va se frayer son chemin en nous offrant des beautés naturelles : sources, torrents, cascades, lacs, …. Mais l’homme intervient. Pour la maitriser et mieux l’utiliser il crée des ouvrages remarquables et souvent grandioses : des citernes et des barrages pour la stocker, des aqueducs pour la transporter, des fontaines pour l’admirer.
Dans les bâtiments, pour s’en préserver, selon le climat et les matériaux, vont apparaître toutes sortes de solutions, des plus simples aux plus ingénieuses, des plus belles aux plus originales.
Aujourd’hui « l’orage est sur le toit » des nouvelles constructions avec toujours les mêmes problèmes : se protéger, réceptionner, canaliser, évacuer ou récupérer. Des solutions, les artisans ou architectes n’ont rien inventé. Certains, utilisant au mieux les nouveaux matériaux ou les nouvelles technologies, ont su les interpréter ou les réinventer.
Pour certains, car pour les autres ….
15h30
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
16h00
Bruno Marchand
EPFL
L’étrange, à la lisière entre le beau et le laid
« Pour que vous aimiez quelque chose il faut que vous l’ayez vu et entendu depuis longtemps, tas d’idiots ». Cette déclaration de Francis Picabia datant de 1920, écrite en lettres capitales sur une pancarte portée par André Breton transformé pour l’occasion en homme-sandwich, questionne le rôle joué par la familiarité dans l’appréciation d’une oeuvre. Cette affirmation peut-elle être rapportée aux notions de beauté et de laideur ?
On aurait ainsi tendance à considérer qu’une oeuvre est belle ou laide en fonction du degré de familiarité de son image ou, selon un autre point de vue et dans le champ architectural, si ses traits formels et stylistiques sont conformes aux codes habituels et partagés ; en d’autres termes, si on peut y reconnaître les lois de l’harmonie et de proportion, ces « vérités réconfortantes » comme les désignait Le Corbusier.
Mais cette question de la familiarité nous oriente aussi vers la notion de l’étrange et vers des objets qui, justement, ne nous apparaissent pas familiers ; des objets dont le caractère singulier confère des impressions inhabituelles et insolites, des objets que l’on pourrait situer à lisière entre le beau et le laid.
L’exposé s’attachera à tisser des liens théoriques entre ces notions, notamment à travers l’analyse de deux oeuvres récentes suisses qui jouent manifestement sur un registre de l’étrangeté et qui, dès lors, posent la question de leur appréciation en tant que « belles » ou « laides » : le Weber Auditorium Plantahof (2008-2010) conçu et réalisé par Valerio Olgiati à Landquart, près de Coire, et le bâtiment édifié par le bureau Diener & Diener au n°14 Bäumleingasse (1999-2005) dans la vieille ville de Bâle.
Bruno Marchand
EPFL
L’étrange, à la lisière entre le beau et le laid
« Pour que vous aimiez quelque chose il faut que vous l’ayez vu et entendu depuis longtemps, tas d’idiots ». Cette déclaration de Francis Picabia datant de 1920, écrite en lettres capitales sur une pancarte portée par André Breton transformé pour l’occasion en homme-sandwich, questionne le rôle joué par la familiarité dans l’appréciation d’une oeuvre. Cette affirmation peut-elle être rapportée aux notions de beauté et de laideur ?
On aurait ainsi tendance à considérer qu’une oeuvre est belle ou laide en fonction du degré de familiarité de son image ou, selon un autre point de vue et dans le champ architectural, si ses traits formels et stylistiques sont conformes aux codes habituels et partagés ; en d’autres termes, si on peut y reconnaître les lois de l’harmonie et de proportion, ces « vérités réconfortantes » comme les désignait Le Corbusier.
Mais cette question de la familiarité nous oriente aussi vers la notion de l’étrange et vers des objets qui, justement, ne nous apparaissent pas familiers ; des objets dont le caractère singulier confère des impressions inhabituelles et insolites, des objets que l’on pourrait situer à lisière entre le beau et le laid.
L’exposé s’attachera à tisser des liens théoriques entre ces notions, notamment à travers l’analyse de deux oeuvres récentes suisses qui jouent manifestement sur un registre de l’étrangeté et qui, dès lors, posent la question de leur appréciation en tant que « belles » ou « laides » : le Weber Auditorium Plantahof (2008-2010) conçu et réalisé par Valerio Olgiati à Landquart, près de Coire, et le bâtiment édifié par le bureau Diener & Diener au n°14 Bäumleingasse (1999-2005) dans la vieille ville de Bâle.
16h30
Pause
Pause
17h00
Jean-Claude Laisné Architecte et urbaniste
L’altération comme projet. Le beau est tombé du ciel pour finir dans un coffre
Au Moyen-Âge, Dieu étant un alibi, l’ornementation architecturale, la peinture, la sculpture, la décoration et les bas-reliefs traduisaient des sentiments opposés, à travers des échelles volontairement déformées, pour représenter des rêves paradisiaques ou des cauchemars apocalyptiques. Cette créativité induite s’est poursuivie à l’âge maniériste et baroque.
Mais dès la Renaissance, le beau redevient un sujet philosophique : il s’humanise. Le regard, le point de vue, la perspective d’un monde en progrès occupent alors le champ de l’architecture. Aux époques ultérieures, l’héritage humaniste, considéré au sens large, a fait évoluer l’idée du beau dans l’architecture, jusqu’au rationalisme. Le beau s’associe même à la technique dès le XIXe siècle pour servir un projet social.
Cette fonction du beau se modifie en 1971, date de la financiarisation de l’économie avec l’abandon de l’étalon or. Commence alors le règne du « beau coup » où le beau n’est toléré que s’il est rentable : l’altération du beau serait-il alors un objectif ? Le beau classique ne suscitait pas de désir, alors que le consumérisme du beau le provoque à tout va. Rem Koolhaas est une figure emblématique de ce cette ère du « beau altéré » : il conçoit ses projets de sorte qu’ils ne soient ni beaux, ni laids. « Le beau c’est une composition esthétique ; s’il y a des choses laides, je dois les laisser ou bien les transformer » expliquait-il à Henri Ciriani en 1985.
Je m’interroge sur les raisons d’une telle défiance à l’égard du beau. Quelle est cette obsessionnelle recherche du « pas suffisamment beau », du « proche du laid » ? Rem Koolhaas ramerait-il à l’envers en regardant s’éloigner l’être aimé tels les architectes soviétiques quittant en bateau la Russie pour rejoindre New York ?
Jean-Claude Laisné Architecte et urbaniste
L’altération comme projet. Le beau est tombé du ciel pour finir dans un coffre
Au Moyen-Âge, Dieu étant un alibi, l’ornementation architecturale, la peinture, la sculpture, la décoration et les bas-reliefs traduisaient des sentiments opposés, à travers des échelles volontairement déformées, pour représenter des rêves paradisiaques ou des cauchemars apocalyptiques. Cette créativité induite s’est poursuivie à l’âge maniériste et baroque.
Mais dès la Renaissance, le beau redevient un sujet philosophique : il s’humanise. Le regard, le point de vue, la perspective d’un monde en progrès occupent alors le champ de l’architecture. Aux époques ultérieures, l’héritage humaniste, considéré au sens large, a fait évoluer l’idée du beau dans l’architecture, jusqu’au rationalisme. Le beau s’associe même à la technique dès le XIXe siècle pour servir un projet social.
Cette fonction du beau se modifie en 1971, date de la financiarisation de l’économie avec l’abandon de l’étalon or. Commence alors le règne du « beau coup » où le beau n’est toléré que s’il est rentable : l’altération du beau serait-il alors un objectif ? Le beau classique ne suscitait pas de désir, alors que le consumérisme du beau le provoque à tout va. Rem Koolhaas est une figure emblématique de ce cette ère du « beau altéré » : il conçoit ses projets de sorte qu’ils ne soient ni beaux, ni laids. « Le beau c’est une composition esthétique ; s’il y a des choses laides, je dois les laisser ou bien les transformer » expliquait-il à Henri Ciriani en 1985.
Je m’interroge sur les raisons d’une telle défiance à l’égard du beau. Quelle est cette obsessionnelle recherche du « pas suffisamment beau », du « proche du laid » ? Rem Koolhaas ramerait-il à l’envers en regardant s’éloigner l’être aimé tels les architectes soviétiques quittant en bateau la Russie pour rejoindre New York ?
17h30
Jean-Philippe Domecq*
Romancier et essayiste
Pourquoi on ne peut plus dire « beau »,
et ce qu’on pourrait bien mettre à la place
Parler de « beau » et de « laid » est a priori impertinent aujourd’hui. C’est l’intérêt, paradoxal, de se repencher sur cette distinction. Elle est évidemment mouvante, historiquement contingente. Au point historique où nous parlons, l’art qui nous est contemporain a hérité de l’art moderne une radicale négation du « beau », parce que celui-ci resta connoté à la tradition, lié à des esthétiques artistiques littéralement conservatrices. Il serait fort peu pertinent de dire aujourd’hui d’une oeuvre qu’elle est belle, cela la disqualifierait aussitôt et décribiliserait l’artiste.
1) Dans un premier temps donc, on rappellera pourquoi, par un historique des critères d’appréciation, que concrétisent les oeuvres les plus cotées et que théorise l’idéologie dominante en art contemporain. Ce qui expliquera pourquoi seuls les nostalgiques ont l’aveuglement idéologique de leur opposer le « beau ».
Pour autant, au vu des résultats, c’est-à-dire encore les oeuvres, force est d’observer qu’il y a un problème… Un problème de productivité qualitative. Voilà ce qu’il nous faut éclaircir. D’où l’intérêt de remettre les pieds dans le plat, comme y invite la question du beau et du laid. L’issue à la productivité quantitative actuelle, est peut-être de se tourner vers le laid, qui mérite au moins autant de distinctions qu’autrefois le beau, et par là produit des oeuvres et démarches fines et fortes.
* Trilogie rééditée sur ce sujet en un volume : Comédie de la critique - trente ans d’art contemporain, éditions Pocket, 2015.
2) La fonction créant l’organe, observons d’où nous vient le désir, qui nous fait trouver quotidiennement un être ou des objets « beaux ». Freud à cet égard a esquissé une piste, qu’il a très peu développée, encore moins que celle de la « pulsion de mort », et qu’il nous appartient donc de vérifier et, éventuellement, prolonger. Freud en effet, partant de la libido, observe que ce qui est a priori choquant, laid, est ce qui devient désirable.
N’est-ce pas une clé pour cerner et hiérarchiser l’intensité d’effet artistique ? N’est-ce pas un moyen d’expliquer qu’il y a des oeuvres et démarches qui nous font plus d’effets que d’autres ?
Moyennant quoi, en synthèse et en fonction des acquis de la modernité et de la contemporanéité, on pourra débattre de comment formuler ce qui nous paraît plus « beau » dans le « laid » qu’autre chose…
Jean-Philippe Domecq*
Romancier et essayiste
Pourquoi on ne peut plus dire « beau »,
et ce qu’on pourrait bien mettre à la place
Parler de « beau » et de « laid » est a priori impertinent aujourd’hui. C’est l’intérêt, paradoxal, de se repencher sur cette distinction. Elle est évidemment mouvante, historiquement contingente. Au point historique où nous parlons, l’art qui nous est contemporain a hérité de l’art moderne une radicale négation du « beau », parce que celui-ci resta connoté à la tradition, lié à des esthétiques artistiques littéralement conservatrices. Il serait fort peu pertinent de dire aujourd’hui d’une oeuvre qu’elle est belle, cela la disqualifierait aussitôt et décribiliserait l’artiste.
1) Dans un premier temps donc, on rappellera pourquoi, par un historique des critères d’appréciation, que concrétisent les oeuvres les plus cotées et que théorise l’idéologie dominante en art contemporain. Ce qui expliquera pourquoi seuls les nostalgiques ont l’aveuglement idéologique de leur opposer le « beau ».
Pour autant, au vu des résultats, c’est-à-dire encore les oeuvres, force est d’observer qu’il y a un problème… Un problème de productivité qualitative. Voilà ce qu’il nous faut éclaircir. D’où l’intérêt de remettre les pieds dans le plat, comme y invite la question du beau et du laid. L’issue à la productivité quantitative actuelle, est peut-être de se tourner vers le laid, qui mérite au moins autant de distinctions qu’autrefois le beau, et par là produit des oeuvres et démarches fines et fortes.
* Trilogie rééditée sur ce sujet en un volume : Comédie de la critique - trente ans d’art contemporain, éditions Pocket, 2015.
2) La fonction créant l’organe, observons d’où nous vient le désir, qui nous fait trouver quotidiennement un être ou des objets « beaux ». Freud à cet égard a esquissé une piste, qu’il a très peu développée, encore moins que celle de la « pulsion de mort », et qu’il nous appartient donc de vérifier et, éventuellement, prolonger. Freud en effet, partant de la libido, observe que ce qui est a priori choquant, laid, est ce qui devient désirable.
N’est-ce pas une clé pour cerner et hiérarchiser l’intensité d’effet artistique ? N’est-ce pas un moyen d’expliquer qu’il y a des oeuvres et démarches qui nous font plus d’effets que d’autres ?
Moyennant quoi, en synthèse et en fonction des acquis de la modernité et de la contemporanéité, on pourra débattre de comment formuler ce qui nous paraît plus « beau » dans le « laid » qu’autre chose…
18h00
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
SAMEDI 28 MAI
10h00
Baldine Saint Girons
Paris X-Nanterre
L’utilité de l’architecture : un problème majeur pour l’esthétique à l’état naissant
En 1746, Charles Batteux refusa de considérer l’architecture comme un des beaux-arts et la regroupa avec l’éloquence dans la classe des arts de la commodité ou des arts du service. Autant dire que l’entrée de l’architecture dans la nouvelle science qui allait devenir l’esthétique, n’allait aucunement de soi. Et ce n’est donc pas étonnant si, aujourd’hui encore, l’architecture oblige à repenser l’esthétique en remettant en cause les idées de contemplation désintéressée, d’espace fictif ou de plaisir esthétique.
Le problème de l’architecture est celui de son intégration dans un espace qui possède une réalité objective et une utilité. On est alors frappé par l’ambivalence du beau, objet d’enthousiasme et d’amour, mais également source de déception, en tant que simple phénomène de surface, paraissant soudain fugace et trompeur lorsque lui manquent la solidité de l’utile, du bon et du vrai. Il s’agira donc de comprendre les formes très différentes sous lesquelles s’exprime un rapport complexe au beau qui va de la revendication d’un fonctionnalisme exacerbé à l’apologie d’une architecture sublime, exclusive de l’utile.
Baldine Saint Girons
Paris X-Nanterre
L’utilité de l’architecture : un problème majeur pour l’esthétique à l’état naissant
En 1746, Charles Batteux refusa de considérer l’architecture comme un des beaux-arts et la regroupa avec l’éloquence dans la classe des arts de la commodité ou des arts du service. Autant dire que l’entrée de l’architecture dans la nouvelle science qui allait devenir l’esthétique, n’allait aucunement de soi. Et ce n’est donc pas étonnant si, aujourd’hui encore, l’architecture oblige à repenser l’esthétique en remettant en cause les idées de contemplation désintéressée, d’espace fictif ou de plaisir esthétique.
Le problème de l’architecture est celui de son intégration dans un espace qui possède une réalité objective et une utilité. On est alors frappé par l’ambivalence du beau, objet d’enthousiasme et d’amour, mais également source de déception, en tant que simple phénomène de surface, paraissant soudain fugace et trompeur lorsque lui manquent la solidité de l’utile, du bon et du vrai. Il s’agira donc de comprendre les formes très différentes sous lesquelles s’exprime un rapport complexe au beau qui va de la revendication d’un fonctionnalisme exacerbé à l’apologie d’une architecture sublime, exclusive de l’utile.
10h30
Mona Chollet
Journaliste au Monde diplomatique et essayiste
Beauté de chair, beauté de pierre
J’ai été amenée à m’interroger sur la conception dominante de la beauté s’agissant du corps humain en général, et féminin en particulier, en écrivant Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine. Puis, dans Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, je me suis posé la même question à propos de nos habitations, en me penchant sur des constructions prestigieuses, qui nous sont désignées comme remarquables : demeures de personnalités aisées, commandes publiques. Entre les deux, entre le physique idéal et le bâtiment idéal, il m’a semblé percevoir de nombreuses similitudes, que je n’ai toutefois pas eu l’occasion d’explorer de façon approfondie. C’est donc ce que je me propose de faire ici. Quelles formes notre culture considère-t-elle comme suprêmement désirables, et quelle philosophie implicite, quelle vision de la vie, quel rapport au monde ces formes traduisent-elles ? Quel rapport, en particulier, au temps qui passe, à la nature – en nous et hors de nous –, quelle économie entre intérieur et extérieur, entre ce qu’il faut montrer et ce qui a vocation à rester caché ? Mais aussi : qu’y a-t-il de problématique dans cette vision ? Et, qu’il s’agisse de nos corps ou de nos maisons, quels idéaux concurrents peut-on lui opposer ?
Mona Chollet
Journaliste au Monde diplomatique et essayiste
Beauté de chair, beauté de pierre
J’ai été amenée à m’interroger sur la conception dominante de la beauté s’agissant du corps humain en général, et féminin en particulier, en écrivant Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine. Puis, dans Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, je me suis posé la même question à propos de nos habitations, en me penchant sur des constructions prestigieuses, qui nous sont désignées comme remarquables : demeures de personnalités aisées, commandes publiques. Entre les deux, entre le physique idéal et le bâtiment idéal, il m’a semblé percevoir de nombreuses similitudes, que je n’ai toutefois pas eu l’occasion d’explorer de façon approfondie. C’est donc ce que je me propose de faire ici. Quelles formes notre culture considère-t-elle comme suprêmement désirables, et quelle philosophie implicite, quelle vision de la vie, quel rapport au monde ces formes traduisent-elles ? Quel rapport, en particulier, au temps qui passe, à la nature – en nous et hors de nous –, quelle économie entre intérieur et extérieur, entre ce qu’il faut montrer et ce qui a vocation à rester caché ? Mais aussi : qu’y a-t-il de problématique dans cette vision ? Et, qu’il s’agisse de nos corps ou de nos maisons, quels idéaux concurrents peut-on lui opposer ?
11h00
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
11h30
Yves Hersant
EHESS
Grâce et beauté: un couple conflictuel ?
Selon la conception « classique », telle que la défendent nombre d’auteurs de la Renaissance, le beau dépend de l’harmonie, c’est-à-dire de la juste combinaison ou disposition des parties : il serait affaire de proportions. Mais certains, ne se satisfaisant pas de cette approche quantitative, ajoutent (ou opposent) un élément qualitatif ; ainsi naissent diverses théories de la grâce, dont celle qui considère comme gracieux ce qui semble accompli sans effort. De ces débats ont résulté des notions nouvelles, comme celle de sprezzatura, et une série de questions : faut-il considérer que l’ordre et la mesure se manifestent gracieusement, ou bien la grâce échappe-t-elle à toute mesure ? Grâce et beauté se complètent-elles, ou s’opposent-elles ? Et dans le cas de l’architecture, selon quels critères pourrait-on dire d’un bâtiment qu’il est gracieux ?
Yves Hersant
EHESS
Grâce et beauté: un couple conflictuel ?
Selon la conception « classique », telle que la défendent nombre d’auteurs de la Renaissance, le beau dépend de l’harmonie, c’est-à-dire de la juste combinaison ou disposition des parties : il serait affaire de proportions. Mais certains, ne se satisfaisant pas de cette approche quantitative, ajoutent (ou opposent) un élément qualitatif ; ainsi naissent diverses théories de la grâce, dont celle qui considère comme gracieux ce qui semble accompli sans effort. De ces débats ont résulté des notions nouvelles, comme celle de sprezzatura, et une série de questions : faut-il considérer que l’ordre et la mesure se manifestent gracieusement, ou bien la grâce échappe-t-elle à toute mesure ? Grâce et beauté se complètent-elles, ou s’opposent-elles ? Et dans le cas de l’architecture, selon quels critères pourrait-on dire d’un bâtiment qu’il est gracieux ?
12h00
Georges Vigarello
EHESS
Les transformations du corps et de la beauté
La recherche toute traditionnelle et classique des proportions idéales du corps fait d’emblée penser à une quasi « éternité » des critères de beauté physique : ils traversent apparemment le temps. Le constat plus trivial de la transformation des modes et des sensibilités dans l’histoire fait en revanche penser aux changements de ces mêmes critères : leur instabilité dans le temps. Rien de discutable, rien de négligeable sans doute aussi, dans de tels changements. Reste que l’interrogation à leur égard doit porter en priorité sur leur contenu précis. Elle doit porter encore sur leur signification : leur convergence possible, par exemple, avec la culture et la mentalité d’une époque. S’y ajoute le fait que la matérialité même des corps change à son tour, non seulement la consistance des chairs, non seulement la stature ou la santé, par exemple, mais la vision même des résistances et des efficacités. Une histoire de la beauté physique ne peut du coup être dissociée d’une histoire concernant l’existence même du corps et son versant le plus concret. C’est à de telles confrontations que sera consacré cet exposé sur les transformations du corps et de la beauté.
Georges Vigarello
EHESS
Les transformations du corps et de la beauté
La recherche toute traditionnelle et classique des proportions idéales du corps fait d’emblée penser à une quasi « éternité » des critères de beauté physique : ils traversent apparemment le temps. Le constat plus trivial de la transformation des modes et des sensibilités dans l’histoire fait en revanche penser aux changements de ces mêmes critères : leur instabilité dans le temps. Rien de discutable, rien de négligeable sans doute aussi, dans de tels changements. Reste que l’interrogation à leur égard doit porter en priorité sur leur contenu précis. Elle doit porter encore sur leur signification : leur convergence possible, par exemple, avec la culture et la mentalité d’une époque. S’y ajoute le fait que la matérialité même des corps change à son tour, non seulement la consistance des chairs, non seulement la stature ou la santé, par exemple, mais la vision même des résistances et des efficacités. Une histoire de la beauté physique ne peut du coup être dissociée d’une histoire concernant l’existence même du corps et son versant le plus concret. C’est à de telles confrontations que sera consacré cet exposé sur les transformations du corps et de la beauté.
12h30
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
13h00
Pause déjeuner
Pause déjeuner
14h30
Marie-José Mondzain
Groupe de sociologie politique et morale (EHESS, CNRS)
« Un tas d'ordures assemblées au hasard : le plus bel ordre du monde »
Le beau et le laid ne spécifient pas deux régimes contradictoires propres à la forme des choses ou des êtres, mais sans doute deux régimes de notre sensibilité en présence de l’apparition de ces formes. Pour ne pas sombrer dans le double écueil d’une distribution normative des valeurs ou d’un relativisme tantôt sceptique et tantôt savant, pourrait-on revenir à ces territoires confus et contradictoires où la pensée grecque, par exemple, notamment Héraclite à qui j'emprunte le titre de mon intervention, tentait de penser ensemble la forme et l’informe, le Cosmos et le Chaos. Dès lors les régimes de sensibilité laisseront entrevoir les ambivalences pulsionnelles où voisinent l’angoisse et la jouissance, la fascination et l’effroi. Il ne s’agit pas de célébrer de complaisantes confusions mais plutôt de faire émerger une zone d’indétermination qui donne leur frappe politique aux choix des formes et à l’usage des mots. C’est à la liberté des gestes et à la joie éprouvée devant les formes quelles qu’elles soient que l’on peut légitimer un recours au lexique de la beauté et de la laideur.
Marie-José Mondzain
Groupe de sociologie politique et morale (EHESS, CNRS)
« Un tas d'ordures assemblées au hasard : le plus bel ordre du monde »
Le beau et le laid ne spécifient pas deux régimes contradictoires propres à la forme des choses ou des êtres, mais sans doute deux régimes de notre sensibilité en présence de l’apparition de ces formes. Pour ne pas sombrer dans le double écueil d’une distribution normative des valeurs ou d’un relativisme tantôt sceptique et tantôt savant, pourrait-on revenir à ces territoires confus et contradictoires où la pensée grecque, par exemple, notamment Héraclite à qui j'emprunte le titre de mon intervention, tentait de penser ensemble la forme et l’informe, le Cosmos et le Chaos. Dès lors les régimes de sensibilité laisseront entrevoir les ambivalences pulsionnelles où voisinent l’angoisse et la jouissance, la fascination et l’effroi. Il ne s’agit pas de célébrer de complaisantes confusions mais plutôt de faire émerger une zone d’indétermination qui donne leur frappe politique aux choix des formes et à l’usage des mots. C’est à la liberté des gestes et à la joie éprouvée devant les formes quelles qu’elles soient que l’on peut légitimer un recours au lexique de la beauté et de la laideur.
15h00
Monique Mosser
Centre André Chastel (CNRS)
Le grand n’importe quoi
de la « nature en ville »
Pendant longtemps, au moins depuis l’invention des promenades et des jardins publics, la « nature » – c’est-à-dire principalement le végétal (arbres, arbustes, fleurs, pelouses) semble avoir entretenu un dialogue relativement équilibré avec l’architecture, les monuments, le bâti urbain en général. Puis la crise écologique aidant, on a vu s’épanouir un nouveau concept : celui de la « nature en ville ». Il s’agit, bien sûr, d’analyser et de prendre en compte les bienfaits (climatiques) et les agréments (esthétiques) que peuvent apporter aux résidents urbains un certain nombre d’innovations proposées, tant par les urbanistes que les architectes, les paysagistes ou encore les scientifiques.
Mais, en même temps, il semble que l’on assiste à d’étranges dérives où la « nature » semble plus instrumentalisée que véritablement respectée, dans des bâtiments publics tels que la Bibliothèque nationale de France, mais aussi dans l’espace public travesti en un Disneyland bucolique à grand frais. Il s’agira de comprendre, à travers divers exemples emblématiques de notre époque, l’idée bien étrange que l’on se fait de la ville mais aussi de la nature.
Monique Mosser
Centre André Chastel (CNRS)
Le grand n’importe quoi
de la « nature en ville »
Pendant longtemps, au moins depuis l’invention des promenades et des jardins publics, la « nature » – c’est-à-dire principalement le végétal (arbres, arbustes, fleurs, pelouses) semble avoir entretenu un dialogue relativement équilibré avec l’architecture, les monuments, le bâti urbain en général. Puis la crise écologique aidant, on a vu s’épanouir un nouveau concept : celui de la « nature en ville ». Il s’agit, bien sûr, d’analyser et de prendre en compte les bienfaits (climatiques) et les agréments (esthétiques) que peuvent apporter aux résidents urbains un certain nombre d’innovations proposées, tant par les urbanistes que les architectes, les paysagistes ou encore les scientifiques.
Mais, en même temps, il semble que l’on assiste à d’étranges dérives où la « nature » semble plus instrumentalisée que véritablement respectée, dans des bâtiments publics tels que la Bibliothèque nationale de France, mais aussi dans l’espace public travesti en un Disneyland bucolique à grand frais. Il s’agira de comprendre, à travers divers exemples emblématiques de notre époque, l’idée bien étrange que l’on se fait de la ville mais aussi de la nature.
15h30
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
16h00
Karim Basbous
ENSA de Paris-Val de Seine / École Polytechnique
L’architecture sans gravité
Le beau architectural est une récompense : il se manifeste lorsque le projet ne cherche pas à plaire, mais se laisse investir de symboles qui le dépassent, lesquels à leur tour portent le sens du projet au-delà de l’actualité. Dans l’oeuvre des maîtres du XXe siècle, la raison et le mystère se disputent les figures, scellant la dimension tragique du fait architectural : Le Corbusier réconcilie la scène antique, austère et exaltée, avec l’idéologie du progrès, tandis que l’oeuvre de Kahn, autrement habitée par le vestige, cherche à réincarner l’esprit des anciens murs pour retrouver l’image et l’aura du sacré. Chez Mies, la quête de l’abstraction conduit le bâtiment à faire le silence, dedans comme autour de lui. Les maisons de Wright, avec leur force tellurique, sont elles-mêmes à l’image du mythe qu’elles racontent : la conquête du plan ouvert par l’architecte rappelle celle du Nouveau Monde par le pionnier. Et Aalto, de son côté, s’est efforcé de sauver l’expression vernaculaire en l’intégrant d’une manière indissociable à la technique moderne.
Ces épopées sont écrites avec des oeuvres inattendues, plénières et souveraines, dédaignant toute causalité technique et pratique, toute facilité et tout compromis. Elles ont élevé pour une dernière fois le projet architectural au rang d’héroïsme. Ce prestige a vécu. Le postmodernisme y a mis fin en destituant le projet, et en vulgarisant le goût de l’architecture (dans les deux sens du terme : répandre largement, et rendre grossier). Depuis, l’idéal véhiculé et promu est celui d’une émancipation à outrance : libéré du savoir, de la mémoire et des combats, de toute instance et de toute responsabilité sociale, le projet architectural peut enfin goûter à la légèreté absolue et inconditionnelle. La comédie a pris sa revanche sur la tragédie. Aux grands récits on préfère désormais les « petites histoires », et l’architecture du plaisir initiatique a cédé la place à celle de l’amusement trivial.
Pourquoi et comment l’ambition d’un savoir universel a pu être remplacée par la satisfaction d’un folklore global ? Comprendre cette destitution est un préalable pour imaginer quel régime de valeurs peut naître des ruines de l’ancien.
Karim Basbous
ENSA de Paris-Val de Seine / École Polytechnique
L’architecture sans gravité
Le beau architectural est une récompense : il se manifeste lorsque le projet ne cherche pas à plaire, mais se laisse investir de symboles qui le dépassent, lesquels à leur tour portent le sens du projet au-delà de l’actualité. Dans l’oeuvre des maîtres du XXe siècle, la raison et le mystère se disputent les figures, scellant la dimension tragique du fait architectural : Le Corbusier réconcilie la scène antique, austère et exaltée, avec l’idéologie du progrès, tandis que l’oeuvre de Kahn, autrement habitée par le vestige, cherche à réincarner l’esprit des anciens murs pour retrouver l’image et l’aura du sacré. Chez Mies, la quête de l’abstraction conduit le bâtiment à faire le silence, dedans comme autour de lui. Les maisons de Wright, avec leur force tellurique, sont elles-mêmes à l’image du mythe qu’elles racontent : la conquête du plan ouvert par l’architecte rappelle celle du Nouveau Monde par le pionnier. Et Aalto, de son côté, s’est efforcé de sauver l’expression vernaculaire en l’intégrant d’une manière indissociable à la technique moderne.
Ces épopées sont écrites avec des oeuvres inattendues, plénières et souveraines, dédaignant toute causalité technique et pratique, toute facilité et tout compromis. Elles ont élevé pour une dernière fois le projet architectural au rang d’héroïsme. Ce prestige a vécu. Le postmodernisme y a mis fin en destituant le projet, et en vulgarisant le goût de l’architecture (dans les deux sens du terme : répandre largement, et rendre grossier). Depuis, l’idéal véhiculé et promu est celui d’une émancipation à outrance : libéré du savoir, de la mémoire et des combats, de toute instance et de toute responsabilité sociale, le projet architectural peut enfin goûter à la légèreté absolue et inconditionnelle. La comédie a pris sa revanche sur la tragédie. Aux grands récits on préfère désormais les « petites histoires », et l’architecture du plaisir initiatique a cédé la place à celle de l’amusement trivial.
Pourquoi et comment l’ambition d’un savoir universel a pu être remplacée par la satisfaction d’un folklore global ? Comprendre cette destitution est un préalable pour imaginer quel régime de valeurs peut naître des ruines de l’ancien.
16h30
Pause
Pause
17h00
Franco Purini
Faculté d’architecture de Rome
L’art du meilleur
L'architecture est un art du meilleur : elle doit rendre toujours plus libres et heureux ceux qui habitent cette terre. Elle ne devrait donc pas se livrer aux expressions de la douleur, de l'inconfort, de la désorientation, du danger, de la laideur ou du mal, mais se dédier exclusivement à accueillir, apaiser, oeuvrer au beau et faire le bien. Toutefois, il n’en va pas ainsi. Le langage de l'architecture est imbriqué dans un complexe d'autres langues au sein desquelles, à l’instar de la poésie, de la littérature, de l’art, du cinéma ou du théâtre, le négatif est omniprésent. Ces langues souillent constamment l'architecture, d'où la dialectique du beau et du laid. Or cette dialectique n’a pour objet que la suprématie du beau. De ce point de vue, il est du plus grand intérêt de comprendre comment la notion de beauté, qui est liée pour moi à un idéal de rationalité comme forme invariante du classique, est régulièrement amenée à contrer son renversement, comme si ce que l’on désigne comme un beau neuf devait fatalement être le contraire du beau obsolète. En ce sens, la catégorie de l’antigrazioso du futurisme est un noeud fondamental, comme le fut en son temps la poésie romantique du XIXème siècle.
Franco Purini
Faculté d’architecture de Rome
L’art du meilleur
L'architecture est un art du meilleur : elle doit rendre toujours plus libres et heureux ceux qui habitent cette terre. Elle ne devrait donc pas se livrer aux expressions de la douleur, de l'inconfort, de la désorientation, du danger, de la laideur ou du mal, mais se dédier exclusivement à accueillir, apaiser, oeuvrer au beau et faire le bien. Toutefois, il n’en va pas ainsi. Le langage de l'architecture est imbriqué dans un complexe d'autres langues au sein desquelles, à l’instar de la poésie, de la littérature, de l’art, du cinéma ou du théâtre, le négatif est omniprésent. Ces langues souillent constamment l'architecture, d'où la dialectique du beau et du laid. Or cette dialectique n’a pour objet que la suprématie du beau. De ce point de vue, il est du plus grand intérêt de comprendre comment la notion de beauté, qui est liée pour moi à un idéal de rationalité comme forme invariante du classique, est régulièrement amenée à contrer son renversement, comme si ce que l’on désigne comme un beau neuf devait fatalement être le contraire du beau obsolète. En ce sens, la catégorie de l’antigrazioso du futurisme est un noeud fondamental, comme le fut en son temps la poésie romantique du XIXème siècle.
17h30
François-Frédéric Muller ENSA de Strasbourg
La nouvelle jeunesse de la ruine
À l’apparition du goût pour la ruine, c’est l’objet antique qui frappe l’imagination. Les tambours de colonnes effondrées ramènent le spectateur plusieurs siècles en arrière. La beauté frissonnante des cadavres de pierre évoque un âge d’or perdu qui sert de modèle. Plus tard, les romantiques entretiennent cette fascination ambivalente pour les monuments éventrés, moins pour nourrir les utopies que pour jouer avec les limites de la beauté et de la laideur. Si une grande partie de la littérature contemporaine perpétue cet amour de la ruine apprivoisée, les industries du jeu vidéo et du cinéma nous saturent d’images de villes détruites dans des convulsions de fin du monde. La ruine n’est plus un objet inerte, elle se fabrique sous nos yeux. Elle n’est plus l’engrais pour le monde à venir mais le spectacle sans cesse renouvelé de notre fin. Dans une complaisance nihiliste d’adolescent attardé, l’image de la ville agonisante est devenue un produit. On ne fera pas un lien direct entre cet univers visuel et la production contemporaine. On cherchera plutôt en quoi ce nouvel âge de la ruine nous renseigne sur notre expérience de la ville post-moderne, en quoi cette vision toujours renouvelée de la fin de l’Histoire confère à des bâtiments d’une laideur commune la beauté étrange d’un freak.
François-Frédéric Muller ENSA de Strasbourg
La nouvelle jeunesse de la ruine
À l’apparition du goût pour la ruine, c’est l’objet antique qui frappe l’imagination. Les tambours de colonnes effondrées ramènent le spectateur plusieurs siècles en arrière. La beauté frissonnante des cadavres de pierre évoque un âge d’or perdu qui sert de modèle. Plus tard, les romantiques entretiennent cette fascination ambivalente pour les monuments éventrés, moins pour nourrir les utopies que pour jouer avec les limites de la beauté et de la laideur. Si une grande partie de la littérature contemporaine perpétue cet amour de la ruine apprivoisée, les industries du jeu vidéo et du cinéma nous saturent d’images de villes détruites dans des convulsions de fin du monde. La ruine n’est plus un objet inerte, elle se fabrique sous nos yeux. Elle n’est plus l’engrais pour le monde à venir mais le spectacle sans cesse renouvelé de notre fin. Dans une complaisance nihiliste d’adolescent attardé, l’image de la ville agonisante est devenue un produit. On ne fera pas un lien direct entre cet univers visuel et la production contemporaine. On cherchera plutôt en quoi ce nouvel âge de la ruine nous renseigne sur notre expérience de la ville post-moderne, en quoi cette vision toujours renouvelée de la fin de l’Histoire confère à des bâtiments d’une laideur commune la beauté étrange d’un freak.
18h00
Séance de questions et débat
Séance de questions et débat
247, Rue Saint Jacques
75005 Paris
Tél. : +(33) 1 56 81 10 25